Lundi 26 avril
J’ai commencé Un coeur si blanc de Javier Marías. La première scène est géniale, à cause du point de vue avec lequel elle est racontée. Je crois que je n’ai jamais lu une entrée en matière si hallucinée et brillante à la fois. On est dans la scène, c’est un drame, ce qui se passe est un peu fou mais pas complètement : juste assez pour créer une impression de vertige. Cependant cela reste un récit, une histoire menée de bout en bout, avec une chronologie, sa logique interne, sa vraisemblance même : la fiction a encore les pieds sur terre. Ce début très impressionnant me rappelle beaucoup Cosmos de Gombrowicz par cet aspect décalé. Mais ici le décalage ne vient pas d’un narrateur qui serait dépassé par la situation, voire pas très net, mais plutôt de la situation elle-même, dont la puissance ne peut être appréhendée frontalement.
Je me souviens que lorsque j’étais en train de lire Cosmos, à chaque trouvaille – autant dire presque à chaque page – je me répétais « il faut que j’apprenne ce livre par coeur, il faut que j’apprenne ce livre par coeur », sans plus avoir conscience de l’énormité de ma promesse : le texte m’avait propulsée ailleurs avec une telle force qu’il ne me semblait pas du tout impossible d’apprendre par coeur un roman entier… Évidemment, j’ai terminé le texte, refermé le livre et n’ai même pas essayé de retenir un quart de tiers de paragraphe.
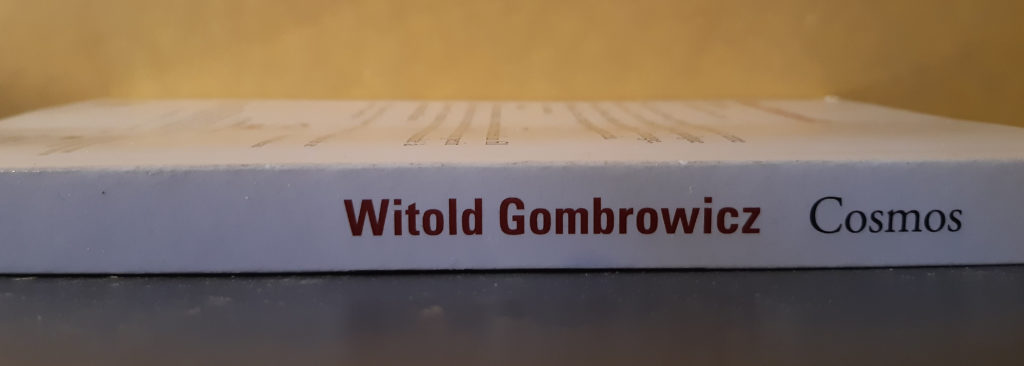
Mais cette réminiscence soudaine est une excellente occasion d’en recopier un extrait marquant. Il est long, je pourrais en mettre moins , mais je n’ai pas vraiment envie de choisir, l’ensemble est à la fois trop beau et trop drôle. Il montre bien en tout cas ce que Cosmos a dans le ventre, quel basculement du réel il est capable d’opérer. Je me contenterai de souligner en gras les étapes de la distorsion. Et alors, en le reproduisant ici, peut-être le génie de ce passage s’ancrera-t-il plus facilement dans ma mémoire :
La profusion étoilée du ciel… incroyable dans ces amas errants se détachaient des contellations, j’en connaissais quelques-unes, la Balance, la Grande Ourse, je les retrouvais, mais d’autres, inconnues de moi, guettaient, comme si elles étaient inscrites dans le plan général des étoiles les plus importantes ; j’essayais de tracer des lignes, qui formaient des figures… et je fus soudain las de les distinguer ainsi, d’imposer une telle carte, je passai dans le jardin, mais là aussi je fus lassé par la multitude d’objets tels que la cheminée, tuyau, coude de gouttière, corniche sur le mur, arbrisseau… mais aussi des objets plus difficiles, parce que plus complexes, comme par exemple le tournant et la disparition d’un sentier, le rythme des ombres… et je me mis, malgré moi, à chercher des figures, des rapports ; je n’en avais pas envie, je me sentis fatigué, impatienté, énervé, jusqu’à ce que j’eusse discerné que ce qui m’attirait, ou ce qui m’enchaînait, peut-être, c’était une chose qui fût « derrière », « au-delà » ; un objet était « derrière » un autre, le tuyau derrière la cheminée, le mur derrière l’angle formé par la cuisine, comme… comme… comme les lèvres de Catherette derrière la bouche de Léna quand, à dîner, Catherette poussait le cendrier à treillis de fer et se penchait au-dessus de Léna en abaissant ses lèvres glissantes et en les rapprochant… Je fus plus surpris qu’il ne convenait, d’ailleurs j’étais un peu porté à l’exagération, de plus les constellations, cette Grande Ourse, etc., m’apparaissaient comme quelque chose de cérébral, de fatigant, je pensai « Quoi ? les bouches ? ensemble ? » et ce qui me stupéfia en particulier, c’était que ces bouches, celles de l’une et de l’autre, maintenant, dans mon imagination, dans mon souvenir, étaient en relation plus étroite que naguère, à table ; je secouai même la tête pour me reprendre, mais le lien entre les lèvres de Léna et celles de Catherette n’en devint que plus manifeste, alors je souris car la déviation dissolue de Catherette, cette fuite vers la saleté, n’avait rien, vraiment rien de commun avec la fraîche ouverture du repli virginal des lèvres de Léna, sauf que l’une était « par rapport à l’autre » – comme sur une carte, comme une ville sur une carte par rapport à une autre – ces idées de cartes ne voulaient plus me sortir de la tête, carte du ciel, ou carte géographique ordinaire avec ses localités, etc. Ce « lien » n’en était pas vraiment un, il s’agissait simplement d’une bouche regardée par rapport à une autre, en fonction, par exemple, de la distance de l’orientation, de la situation, rien de plus… mais le fait est que moi, calcultant que la bouche de Catherette devait se trouver quelque part à proximité de la cuisine (là où elle couchait), je me demandai où, de quel côté et à quelle distance de cet endroit pouvait se trouver la petite bouche de Léna. Et la luxure froide qui me poussait vers Catherette dans ce corridor dévia à cause de cette intrusion marginale de Léna.
À cela s’ajoutait une distraction croissante. Rien d’étonnant : une concentration excessive sur un seul objet provoque la distraction ; cet unique objet masque tout le reste, en fixant un point de la carte nous savons que tous les autres nous échappent. […] devant moi, le jardin, les arbustes, les sentiers qui se terminaient par une place avec un tas de briques jusqu’au mur étonnamment blanc, tout cela m’apparut comme un signe visible de ce que je ne voyais pas : l’autre côté de la maison où il y avait aussi un bout de jardin, puis la clôture, la route, et derrière celle-ci le fourré… et la tension du monde stellaire se fondit en moi avec celle de l’oiseau pendu. Fuchs était-il là-bas près du moineau ?
Le moineau ! Le moineau ! À vrai dire ni le moineau ni Fuchs n’éveillaient mon intérêt, la bouche, certes, était autrement intéressante… Ainsi pensai-je distraitement. J’abandonnai donc le moineau pour me concentrer sur la bouche et il se créa ainsi une sorte de tennis épuisant car le moineau me renvoyait à la bouche, la bouche au moineau, je me trouvais entre les deux, et l’un se cachait derrière l’autre ; dès que j’atteignais la bouche, vivement, comme si je l’avais perdue, je savais aussitôt que derrière ce côté de la maison, il y avait l’autre et, derrière la bouche, le moineau solitaire qui pendait…
[…]
Catherette déposa devant Léna le cendrier au treillis de fil de fer. Léna fit tomber sa cendre, je crus revoir sa jambe sur le treillis du lit, mais j’étais distrait, une bouche au-dessus d’une bouche, l’oiseau et son fil de fer, le poulet et le moineau, son mari et elle, la cheminée derrière la gouttière, les lèvres derrière les lèvres, bouche et bouche, arbustes et sentiers, arbres et route, trop de choses, à tort et à travers, vague après vague, abîme de distraction, de dispersion. Distraction. Douloureux égarement. Là-bas, dans un coin, il y avait une bouteille sur l’étagère et l’on voyait une chose collée à son goulot, peut-être un morceau de bouchon…
… Je m’attachai à ce bouchon et me reposai avec lui jusqu’au moment d’aller dormir […]

Toute la force de ce passage tient à un fait pourtant désarmant de simplicité : les relations entre les choses sont peu à peu réduites au strict minimum. Mais c’est tout le cheminement délirant du personnage, la logique intime qui a précédé qui permettent cette association finale de toutes choses. Le narrateur se sait distrait, dans son esprit au-dessus de devient derrière qui devient et, pour finir en une courte suite de juxtapositions. Les catégories comme les hiérarchies ont disparu (et c’est ce qui est infiniment aimable).
Si je reviens maintenant à Un coeur si blanc, le principe est assez proche. Tout est déjà contenu dans une phrase de Gombrowicz : « Cet unique objet masque tout le reste, en fixant un point de la carte nous savons que tous les autres nous échappent » .
Voilà en effet ce qui se passe dans ce début si déroutant du roman de Marías. Alors qu’un suicide vient d’avoir lieu, le narrateur porte une attention excessive sur tel détail, puis sur tel autre par un jeu d’associations absurde, s’éloignant de plus en plus du corps sans vie, pour ne plus le décrire finalement que par ce qui l’entoure (c’est-à-dire par ce que ce corps n’est pas). Ce qui était décrit avec précision l’instant d’avant semble ainsi s’effacer sous la masse des données, ou plutôt : chaque détail se superpose au point d’effacer toute possibilité de hiérarchie dans l’esprit cette fois du lecteur. C’est à ce dernier de reconstituer tant bien que mal les liens entre les éléments, exactement comme le faisait le héros perturbé de Cosmos.
Je le sais déjà, je n’ai pas fini de parler du texte de Marías. En attendant je retourne à ma lecture, balle creuse projetée sur un court entre les deux romans.
3 commentaires sur “29 – rebonds”