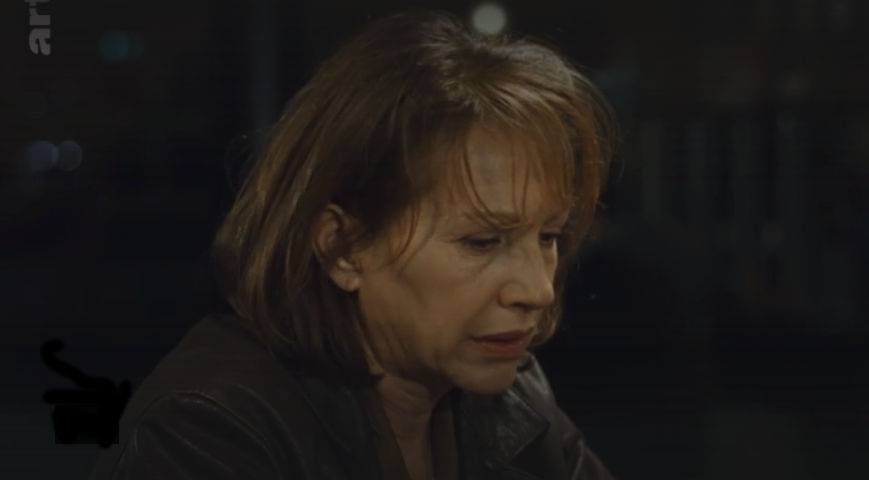Mardi 13 juillet
1 – « Tout ce qui nous arrive, tout ce dont nous parlons ou qui nous est relaté, ce que nous voyons de nos propres yeux ou qui sort de notre bouche ou entre nos oreilles, tout ce à quoi nous assistons (et dont, par conséquent, nous sommes en partie responsables), doit avoir un destinataire extérieur à nous-mêmes, et ce destinataire nous le sélectionnons en fonction de ce qui nous arrive ou de ce que l’on nous dit, ou encore de ce que nous disons. Chaque chose doit tôt ou tard être racontée à quelqu’un – pas toujours à la même personne, pas nécessairement -, et chaque chose est mise en réserve comme on le fait lorsqu’on examine et qu’on éliminte et qu’on attribue de futurs cadeaux un après-midi d’emplettes. Tout doit être raconté au moins une fois, même si, comme l’avait décrété Rylands avec toute son autorité littéraire, il y a un temps pour cela. Ou, en d’autres termes au bon moment et parfois pas du tout, si l’on n’a pas su reconnaître ce moment ou si on l’a délibérément laissé passer. Ce moment se présente parfois (le plus souvent) de façon immédiate, pressante et sans ambiguïté, mais bien d’autres fois, il se présente confusément et seulement après des lustres et des décennies, comme c’est le cas pour les plus grands secrets. Quoi qu’il en soit, aucun secret ne peut ni ne doit être gardé à jamais envers quiconque, et il doit absolument trouver ne serait-ce qu’un destinataire une fois dans la vie, une fois dans sa vie de secret.
C’est pourquoi certaines personnes réapparaissent. »
2 – « Mais comme je ne sais pas qui elle est et qu’il est possible que je ne la revoie jamais, je crois que je pourrais commencer à penser ausi à ton amie Clare.
‘Quel idiot me dis-je, pourquoi ne puis-je pas penser à des choses plus fructueuses et plus intéressantes ? Les relations non-consanguines ne le sont jamais, la variété possible des conduites est minime, les surprises sont feintes, les pas sont des démarches, tout est puéril : les approches, les accomplissements, les éloignements ; la plénitude, les combats, les doutes ; les certitudes, la jalousie, l’abandon, le rire ; tout fatigue avant de commencer.' »

3 –
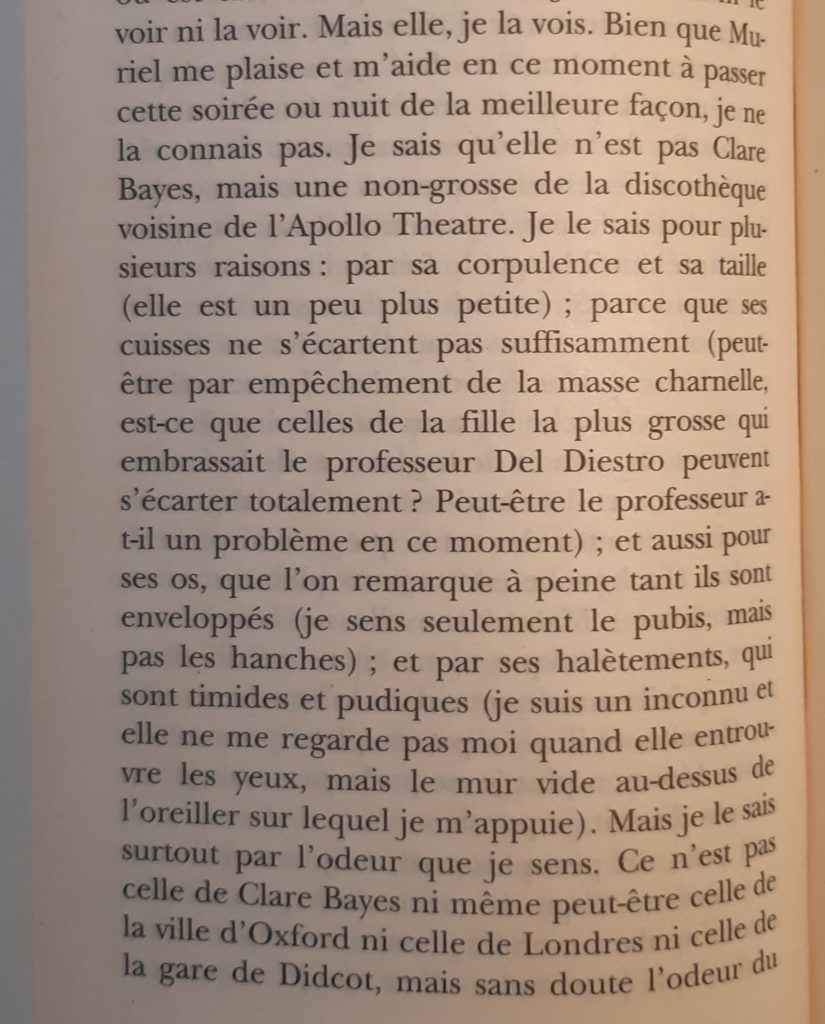
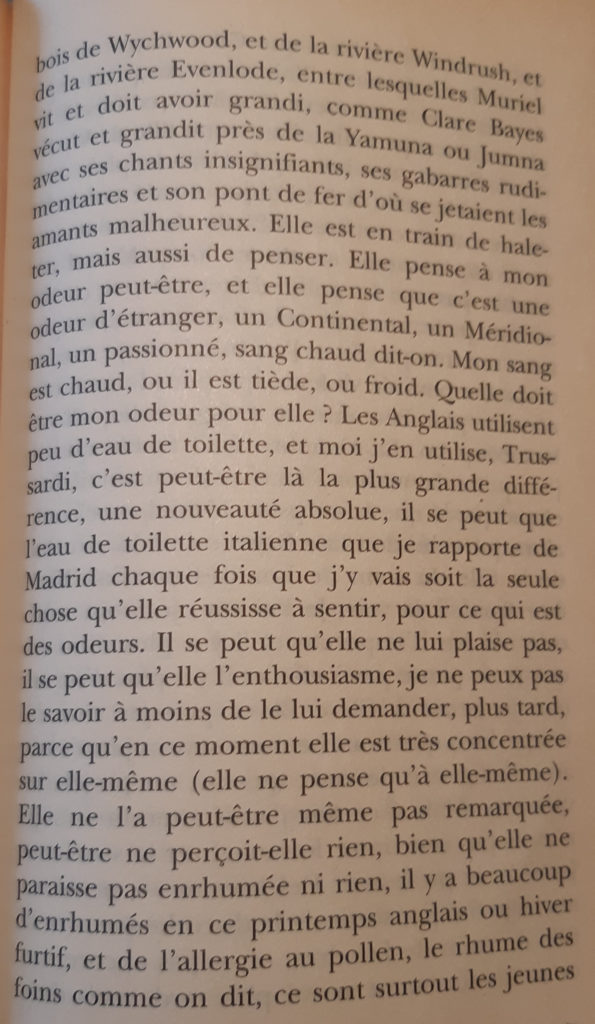
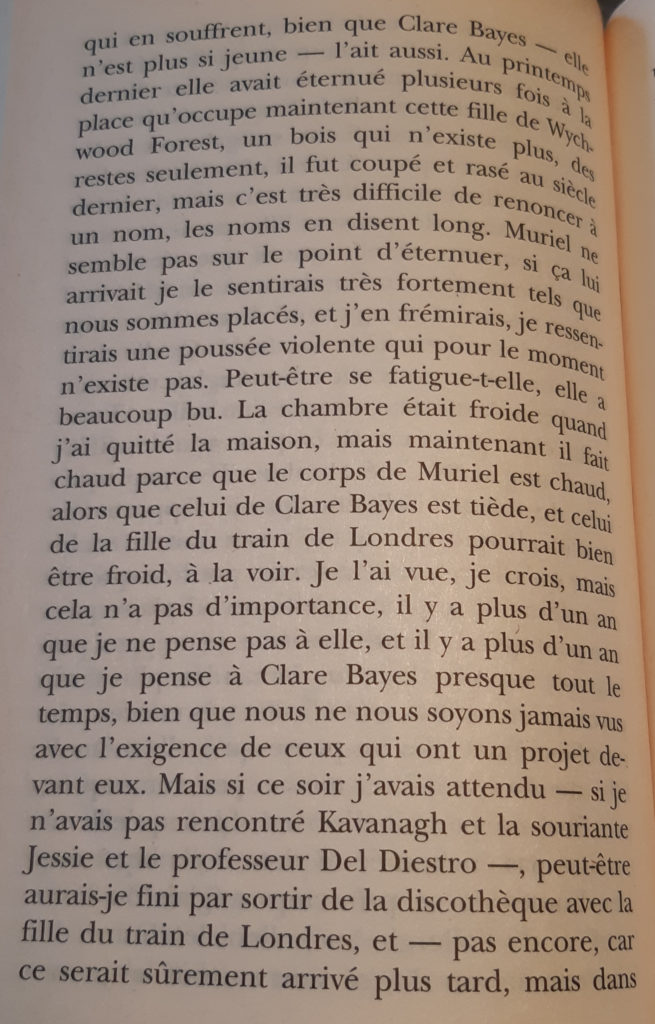
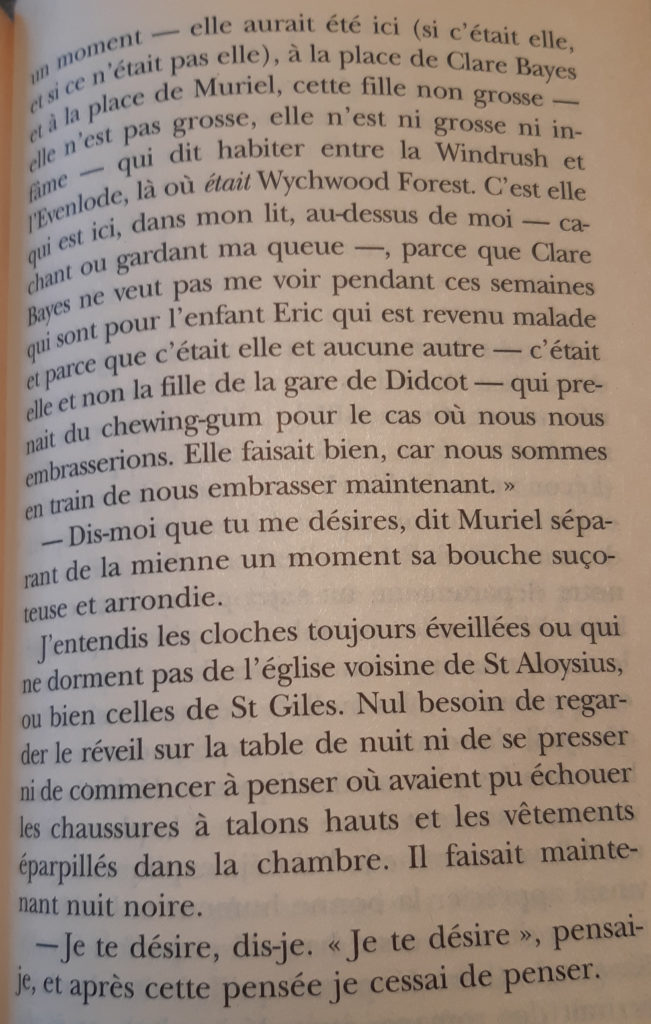
4 – « Et je ressentis la grande consolation (peut-être même un immense plaisir) de proposer l’impossible dont on sait qu’il ne sera pas accepté : car ce sont justement l’impossibilité évidente et le refus assuré – le refus que ne fait rien d’autre qu’attendre celui qui propose et prend la parole le premier – qui permettent de parler sans réserve et d’être véhément, de se montrer plus sûr en exprimant ses désirs que s’il existait la moindre chance de les voir satisfaits. Et Clare Bayes feignit de me croire – je crois -, de me prendre au sérieux, et elle me donna des explications comme si elles étaient vraiment nécessaires et qu’un non ne suffisait pas, comme s’il fallait qu’elle s’efforçât de ne pas me blesser et qu’il était important que je comprenne (elle se comporta avec délicatesse). «
Texte d’un Javier Marías alors débutant – le dernier trouvé en traduction française.