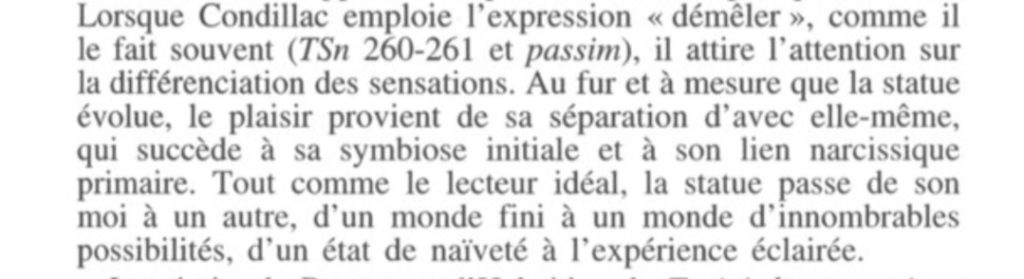Jeudi 23 décembre
Après le saut temporel d’hier, plongée rapide dans l’écriture du siècle des Lumières. J’aurais pu prendre l’abbé Prévost pour modèle, puisqu’en lisant l’article je me suis souvenue à quel point j’avais été marquée à certaine époque par Manon Lescaut puis dans sa foulée Cleveland. Ce sera pourtant Rousseau et son livre des Confessions l’un et l’autre plus connus que je citerai. Il faut voir en effet comme l’auteur passe par la négation pour mieux atteindre l’existant. Chez lui, c’est le détour qui permet de toucher le plus sûrement sa cible. Cela donne une voix qui nuance et ce faisant, avance, pour à la fin affirmer en niant tout le reste. Ainsi approche-t-on, pas à pas, de la justesse (plus exactement : l’expression juste du sentiment). Rousseau est toujours subtile, non d’une subtilité un peu oiseuse, qui se gargariserait des mots qu’elle utilise mais au contraire vise et fait mouche.
Livre premier (1712 – 1728)
« Nous fûmes mis ensemble à Bossey en pension chez le Ministre Lambercier, pour y apprendre, avec le latin, tout le menu fatras dont on l’accompagne sous le nom d’éducation (a). Deux ans passés au village adoucirent un peu mon âpreté romaine, et me ramenèrent à l’état d’enfant. A Genève, où l’on ne m’imposait rien, j’aimais l’application, la lecture; c’était presque mon seul amusement. A Bossey, le travail me fit aimer les jeux qui lui servaient de relâche (b). La campagne était pour moi si nouvelle que je ne pouvais me lasser d’en jouir. Je pris pour elle un goût si vif, qu’il n’a jamais pu s’éteindre. Le souvenir des jours heureux que j’y ai passés m’a fait regretter son séjour et ses plaisirs dans tous les âges, jusqu’à celui qui m’y a ramené. M. Lambercier était un homme fort raisonnable, qui, sans négliger notre instruction, ne nous chargeait point de devoirs extrêmes. La preuve qu’il s’y prenait bien est que, malgré mon aversion pour la gêne, je ne me suis jamais rappelé avec dégoût mes heures d’étude, et que, si je n’appris pas de lui beaucoup de choses, ce que j’appris je l’appris sans peine, et n’en ai rien oublié.«
Il s’opère comme une accumulation de savoirs/sensations telle que peu importeraient presque ce qui est et n’est pas : seule la somme compte véritablement, c’est elle qui s’avère moyen de connaissance. Ainsi, (a) qui additionne des éléments entièrement positifs (latin + menu fatras = éducation) et (b) qui s’avère plus complexe (le jeu n’est ni l’application, ni la lecture, ni le travail et pourtant il est un « amusement » qui n’existerait pas sans eux) finissent par agir de manière très similaire sur notre compréhension. Quelque part, a et b obéissent à une structure commune.
Inutile de préciser (!) que je me reconnais une très grande familiarité avec cette manière de penser ; et c’est ce procédé de soustraction/addition que j’aime le plus chez Rousseau. Il l’a poussé à sa plus belle expression.
Et sinon, à garder dans un coin de cerveau, ce passage du même livre, non tant pour l’usage quoique toujours remarquable de la négation, mais plus encore pour l’humour de l’adresse :
« Je sais bien que le lecteur n’a pas grand besoin de savoir tout cela, mais j’ai besoin moi de le lui dire. Que n’osé-je lui raconter de même toutes les petites anecdotes de cet heureux âge, qui me font encore tressaillir d’aise quand je me les rappelle ! cinq ou six surtout… Composons. Je vous fais grâce des cinq ; mais j’en veux une, une seule, pourvu qu’on me la laisse conter le plus longuement qu’il me sera possible, pour prolonger mon plaisir. Si je ne cherchais que le vôtre, je pourrais choisir celle du derrière de mademoiselle Lambercier, qui, par une malheureuse culbute au bas du pré, fut étalé tout en plein devant le roi de Sardaigne à son passage : mais celle du noyer de la terrasse est plus amusante pour moi qui fus acteur, au lieu que je ne fus que spectateur de la culbute. »