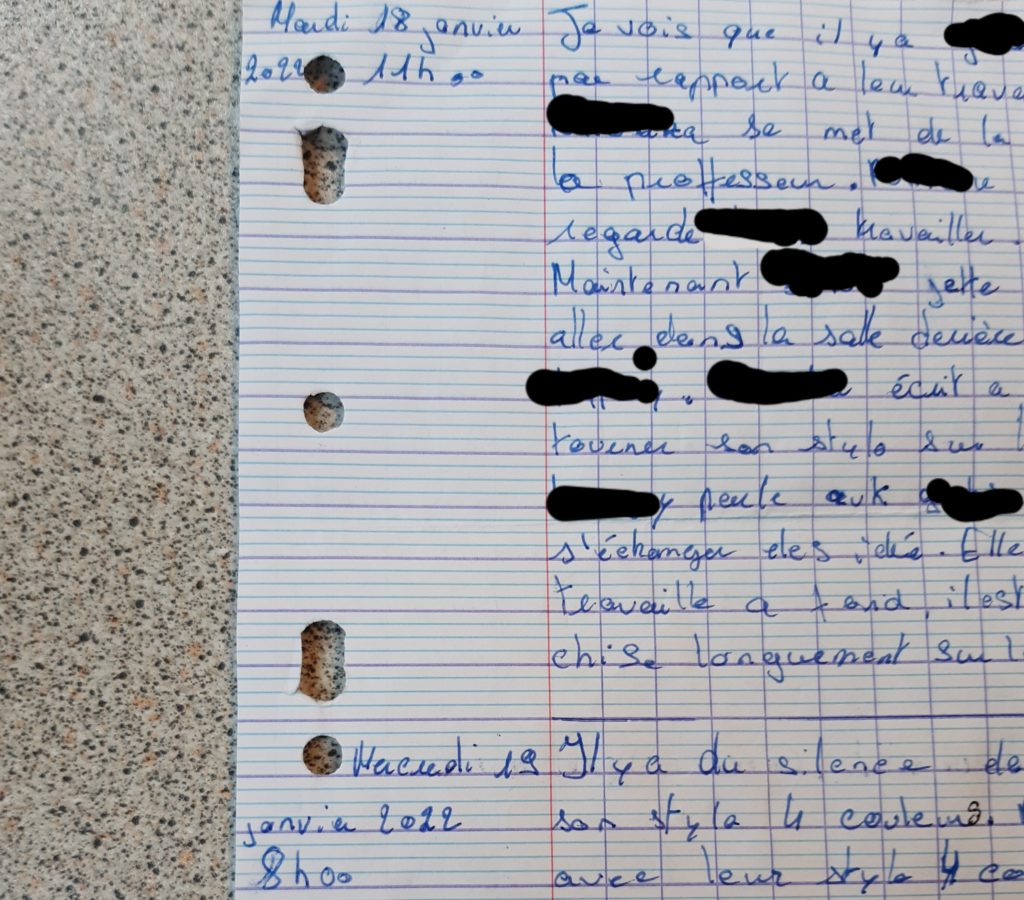Dimanche 30 janvier
Le premier jour j’allai à l’adresse indiquée sur le document de l’hôpital. Je m’avançai jusqu’à un grand immeuble en vieille pierre et me posai devant l’interphone. Par chance il y avait bien parmi la petite dizaine des noms inscrits un Frédéric Fossaert. Il vivait toujours là, deux ans après sa rupture avec Élodie. J’y songeai mais ne sonnai pas. Je n’avais aucune raison de lui parler. Rien à lui dire. L’envie de le voir me démangeait. Ne serait-ce que pour savoir à quoi il ressemblait. Quelle était son allure. Si Élodie avec moi avait perdu au change. Je traversai la route pour regarder la façade. Me postai contre le grillage du petit parc en face. L’heure de fin de travail n’était pas encore arrivée pour la plupart des citadins, le parc était vide, le soleil commençait à décliner. Rares étaient les lumières allumées dans ces grandes pièces hautes et aux fenêtres immenses. Tout semblait immobile à l’intérieur, très calme, tandis que dehors la circulation était dense. Sur les trottoirs les passants s’évitaient. Bientôt ils sortiraient par jets des bouches de métro. J’étais venu sans plan d’action. Le désir de voir ce type ne diminuait pas. Je restai ainsi quelques minutes. Reçus un texto d’Élodie : tu me rejoindras ce soir ? Puis finis par partir, les mains dans les poches. Le téléphone chauffait le creux de ma paume.
Je revins deux jours plus tard à la même heure. J’avançai à nouveau jusqu’à la grande porte mais cette fois appuyai du bout de l’index sur le bouton de la sonnerie de Fossaert. Sans hésitation. Silence. Sonnerie. Silence. Personne ne répondait, personne n’était là-haut. Je ne me retournai pas pour ne pas sembler louche. Sortis de ma poche un rouleau de scotch et une petite bande de papier avec lesquels je fis du découpage puis un peu de collage en insistant bien sur les bords latéraux pour cacher solidement le nom. Je revins cette fois à ma voiture que j’avais réussi à garer à distance convenable. Attendais en écoutant le début d’un podcast sur Richard Stallman, puis quelques morceaux d’electro-hip-hop, puis la fin de l’émission. Pendant ce temps-là je vis entrer dans l’immeuble tour à tour quatre personnes dont une femme un peu forte ; plus tard un adolescent blafard qui arriva en skate et le ficha pile sous son aisselle avec une fluidité admirable au moment même où il posait le pied sur la première marche du perron. Aucune des quatre premières personnes ne réagit en tapotant sur le digicode situé juste sous l’interphone pour entrer dans la cour de l’immeuble. C’est peu avant 18h qu’un homme vêtu d’une courte veste en cuir brun, s’y arrêta plus longtemps.
Cette étape de l’écriture est cruciale. Elle inaugure quelque chose de radicalement inédit : est en train de jaillir, doucement, à bas bruit, un roman à suspense. Voilà que je déroule une enquête, imagine un thriller. Invente à la fois une énigme et les moyens de sa résolution. Et veux obéir pour la première fois aux codes du genre. Écrire un vrai roman, pour paraphraser Cyrano accédant à un nouveau mode de discours, « c’est si délicieux, c’est si nouveau pour moi. » Ce serait un peu comme se mettre, après vingt ans à rejeter l’idée même de corps individuel, à faire du yoga plusieurs heures par jour. Ou après plus de quarante de refus de penser le passé, décider coup sur coup de se plonger trois mois entiers dans le XVIIIème siècle et faire de l’histoire familiale un objet littéraire.
Avoir plusieurs vies. Mais quelle chance.