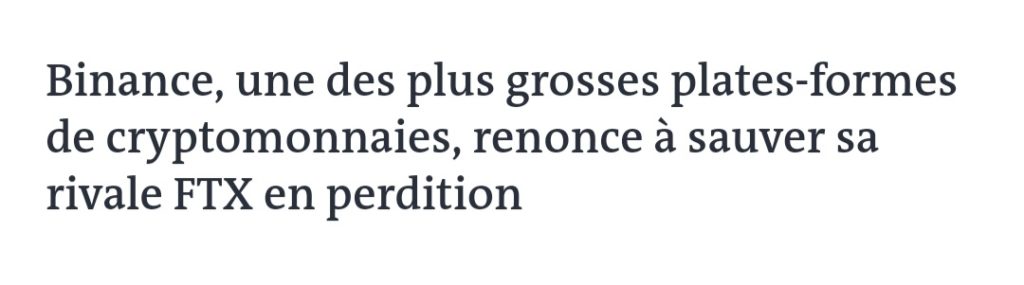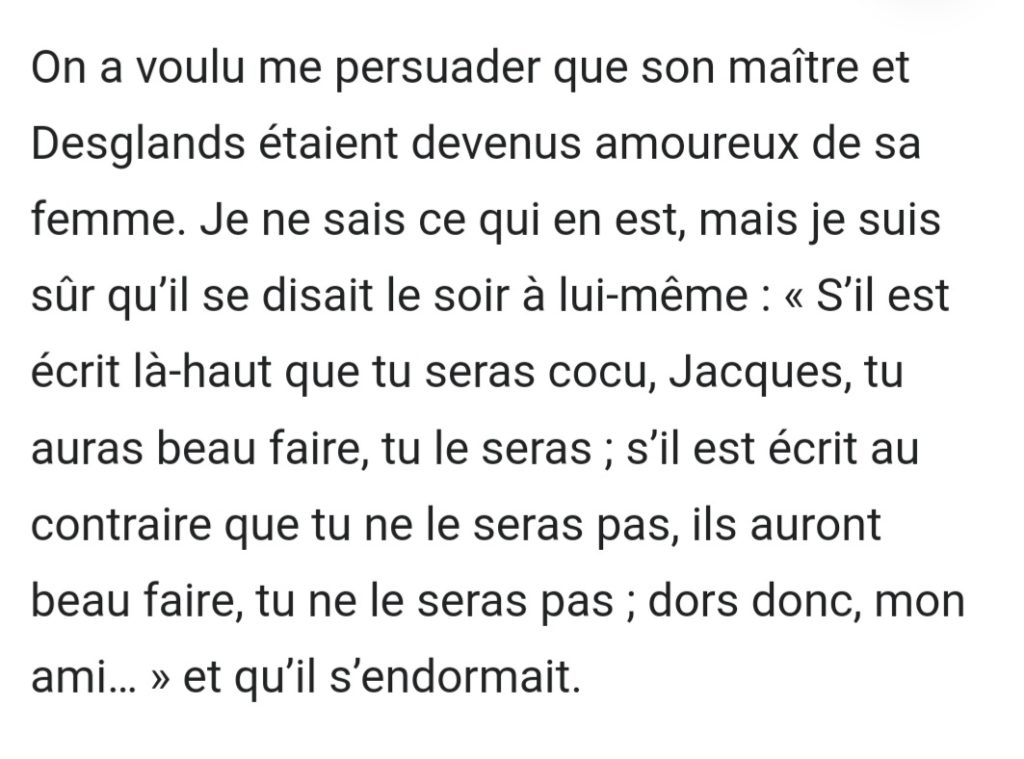Samedi 12 novembre
Viens de voir Eo de Jerzy Skolimowski, non sans au départ une légère appréhension, car j’avais été assez fascinée par Essential Killing et me doutais d’après la bande-annonce que l’épure cette fois n’y serait plus. Mais contre toute attente, la filiation avec le film de 2010 m’a semblé plus frappante que la rupture. Dans E. K. les forêts étaient blanches, ici elles sont rouges. À chaque fois, sublimes. Dans les deux films des personnages muets fuient et/ou errent au gré des circonstances. Leur solitude en commun, chaque rencontre avec les humains prend le tour d’un accident, avec le sentiment que cette forme de nomadisme pourrait durer des heures si le héros ne finissait par mourir, pas clairement dans E. K., plus bruyamment dans Eo (1). Car dans ces films où le personnage n’a d’autre but que le vagabondage, il faut bien que quelque chose s’arrête et laisse place au générique final. C’est une contrainte légitime du réalisateur, mais pas seulement.
Le constat, en effet, y est toujours le même : les hommes condamnent celui qui ne leur ressemble pas et est incapable de suivre leur agitation à une mort certaine. C’est une question de mouvement. D’incompatibilité de mouvement : les errances des uns et de l’autre ne sont pas du même type, ne suivent pas les mêmes lois, y compris rythmiques. A l’image de la jeune écuyère de cirque, la première propriétaire d’Eo qui l’aime tant mais doit repartir à moto après lui avoir fêté brièvement son anniversaire. Animaux et êtres humains ne peuvent faire autrement que se croiser. Mais dans Eo le propos se radicalise en même temps que le sentiment d’une impasse – une impasse qu’on pourrait qualifier d’ontologique.
Ici, les hommes eux-mêmes ne savent faire autre chose que s’entredéchirer. Ils multiplient les conflits et les comportements grotesques (cf la scène de dispute au fumet incestueux entre une Isabelle Huppert totalement sordide, au visage sans âge et caché sous un masque de maquillage, et son superbe fils, cliché de l’aristocrate décadent ; l’inauguration désuète d’un entrepôt par les notables ventripotents du bourg), assassinent gratuitement (un chauffeur sympathique), courent après des ballons au nom d’une couleur, celle de leur équipe, pour finir par se donner des coups de battes.
Les quelques interactions humaines apparaissent ainsi comme de piteuses interférences, dont la conséquence s’abat directement sur les animaux. Les mouvements et l’errance naturelle de ces derniers sont sans cesse entravés par des êtres absolument insensés. Il s’opère comme une contamination irrémédiable. Une toxicité se déploie tous azimuts, au point d’atteindre tous les animaux qui croisent la route des hommes. Ceux-ci par exemple ne cessent de forcer Eo à avancer d’un point à un autre (lui qui ne semble pourtant ne tendre qu’à aller sans but), quitte à l’enfermer dans des containers successifs pour le transporter malgré lui. Comme ils le font en réalité, et cela nous sera clairement donné à voir, avec tous les animaux domestiqués : cochons, chevaux, bovins.

Finalement, avec cette base scénaristique simple d’une pérégrination perdue d’avance par un héros isolé, le reste tout le reste, c’est-à-dire la, ou plutôt les formes pouvaient varier. Jusqu’à devenir un véritable feu d’artificeS. Tantôt une caméra instable va au plus près de l’œil invariablement sale, inexpressif et larmoyant de l’âne ; tantôt elle s’envole au-dessus des arbres en suivant avec grâce une rivière, pour s’arrêter sur la robe et la musculature d’un cheval qu’on savonne de haut en bas ; pour suivre quelques instants le parcours fragile d’une fourmi ; fixer un moment le tableau d’une étable grise et brune dans une asinerie de campagne ; ou encore se perdre dans des bouillons d’eau montés à l’envers. De cette grande variation picturale, j’ai pour ma part tout aimé – chaque plan, même les plus limites, les plus inconfortables. Car quel que soit le choix formel du réalisateur, quel que soit l’angle par lequel il décide d’aborder tel épisode du parcours d’Eo, il parvient toujours à construire de la tension. Scène après scène, plan après plan, même là – et peut-être grâce à cela – où l’on ressentirait au départ une certaine réticence, voire une répulsion esthétique, légère ou moins, le film s’avère d’une intensité totale.
À ce titre et en conséquence, on peut dire que dans son style – celui-là même qu’il s’est inventé – Eo est un film parfait.

Mais il est d’autant plus réussi que cet artifice assumé n’est jamais gratuit. On saura gré au réalisateur d’avoir évité de nous faire croire qu’on se trouve dans la peau d’Eo et perçoit le monde entièrement de son œil mouillé. Toute vision, tout sentiment prêté à l’animal n’est à vrai dire qu’une projection, comme lorsque un personnage évoquant à voix haute le goût du salami fait semblant de croire qu’il a coupé l’appétit d’Eo. Tout au long du film on devine, on essaie, on attrape quelques bribes, mais en fait, tout ce qui nous est montré est de l’ordre de l’artifice, de la reconstitution. À commencer par ces multitudes d’animaux. Toutes ces espèces, en réalité, ont été fabriquées par l’homme. Elles sont, à tout le moins, le fruit de sa vision. Dans Eo il n’y a pas d’état de nature.
Ainsi la forêt de nuit est-elle réduite à un lieu irréel, celui des contes de l’enfance. Le jardin de la comtesse – dont le portail s’ouvre et se ferme mystérieusement – apparaît comme une clairière dérisoire et d’un vert impossible. L’âne ne parvient pas à y brouter la pelouse. Dans cet environnement dominé, phagocyté par l’homme, plus aucun lieu n’est viable à long terme. Même les moments passés dans une prairie avec des enfants trisomiques ne permettent nul répit à Eo, devenu dans cette courte séquence indistinct de ses congénères. Les enfants semblent certes ravis, mais des ânes on n’apercoit plus que les pattes : ils sont littéralement éjectés du cadre. L’atmosphère de bonheur, symbolisée par des cerfs-volants clicheteux, n’a rien de solide. En guise de complicité entre de petits être fragiles, on nous vendra un déballage de jolies images, voilà tout. De toute manière, il faudra bientôt de nouveau les porter sur le dos, ces bambins, puisque les bêtes aux yeux des humains ne sont bonnes qu’à trimer pour eux.
Si antispécisme il y a dans le film, ce que je crois – le crois parce que le suis, antispéciste, et que dans ce domaine toute accointance est précieuse, furtive, s’attrape à l’arrachée. Mais soyons honnête : rien ne le garantit vraiment. Un tel positionnement ne se prend pas, en tout cas, pour autre chose que ce qu’il est. À savoir une projection multiple et fantasque du réalisateur sur des êtres qui lui échappent. Il se veut aussi parfois ironique. Sans illusion sur sa nature : en passant d’image en image, en construisant des liens logiques et temporels via le montage, on reste finalement enfermé dans la tête d’un homme. Celui-ci a beau aller vers d’autres formes de vie, il n’ignore pas moins qu’il ne pourra jamais les atteindre tout à fait. Mais à mon sens c’est là la plus belle preuve d’amour qu’on puisse leur manifester. (2)
(1) Ne manquait alors que le fameux « Cut ! » crié par le réalisateur.
(2) À ce propos, la note de fin de film est autrement plus émouvante que les remerciements de Claire Denis à Agnès B à l’issue de Trouble every day. Un mot précise en effet qu’Eo a été fait par amour pour les animaux et qu’en conséquence, aucun mal ne leur a été infligé pendant le tournage. Peut-on faire plus beau ?