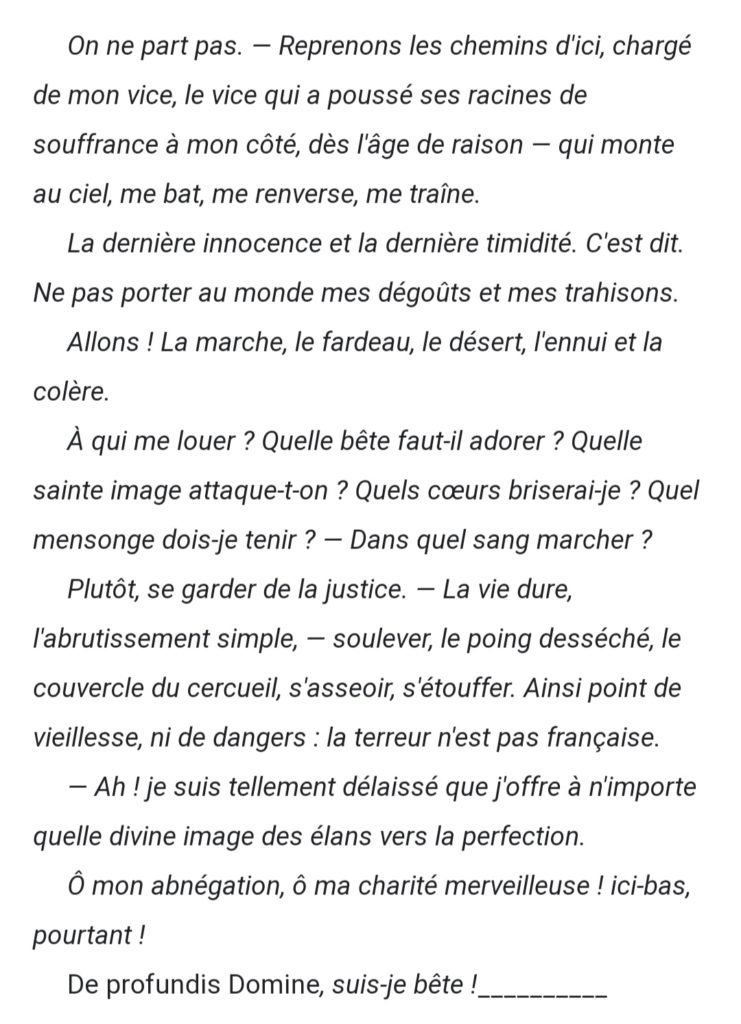Samedi 4 juin
Vu À nos amours. Étonnée de la grande tristesse qui domine ce film, déjà contenue d’ailleurs dans son très beau titre. Je ne comprends pas pourquoi il est si triste. Quelle sombre énergie le meut, ni quel soubassement moral ou existentiel en a déterminé le ton. Il parle d’une jeune fille assez libre, qui à plusieurs reprises fait remarquer à ses parents séparés qu’il faut penser à soi, se faire plaisir ; d’une jeune fille qui se laisse aller à son désir et revendique une forme d’égoïsme. Pourtant, tout dans cette histoire suinte la tristesse, l’impuissance et la désillusion. Suzanne, surtout, semble subir ses propres comportements. Elle se dit malheureuse.
Car elle couche avec les hommes qu’elle vient à rencontrer tandis qu’elle sèche ses cours et sort le soir, mais ne peut rester avec celui dont elle est amoureuse. Comment l’expliquer ? Certes, on pourrait toujours décider de prendre le personnage comme il est, sans véritable psychologie. Suzanne serait selon son père incapable d’aimer, point. De fait, pas grand-chose nous la rend sympathique (ce qui, en soi, n’est pas un problème cinématographique). Disons que Suzanne est une adolescente parfaite. Une ado parfaitement jouée. Néanmoins un contexte familial précis nous est donné, et en détail. Difficile de ne pas voir là une invitation à l’analyse. Voici ce que celle-ci nous donne :
1) Suzanne adore son père (dit plusieurs fois), et réciproquement
2) sa mère, qu’elle déteste, est fragile, peut-être folle
3) son frère adule sa mère (et réciproquement)
On a là un schéma psychanalytique on ne peut plus classique. Suzanne semble engluée dans le complexe d’Oedipe et ne parvient pas à aimer les hommes convenablement. Ceux qu’elle estime lui restent interdits (Luc, comme son père – notons que c’est Pialat lui-même qui s’est attribué ce rôle) ; alors elle multiplie les aventures avec d’autres, qui ne comptent pas.
Si on ajoute à cela une éducation aux valeurs traditionnelles (une jeune femme doit arriver vierge au mariage), et surtout une tendance au sein du même foyer à se taper dessus (de la simple gifle à des coups plus violents), on saisit tout le poids du malheur que traîne la jeune héroïne. Penser, froidement, qu’il faut jouir de la vie comme le fait Suzanne ne suffit plus. Les impasses du milieu familial la rattrapent invariablement. Même les fêtes entre jeunes semblent sinistres. Telles des soirées inversées ou bien les restes glauques de celles de la libération sexuelle de la décennie précédente. Ici, sous une légèreté de façade les relations pèsent des tonnes, nulle joie ne s’en dégage. Les scènes dans les lits sont toujours esquivées. Heureusement, on entrapercoit de temps en temps les seins de Sandrine Bonnaire ou un corps masculin allongé. Mais le tout est produit par dépit. Sans sualité. Il n’y aurait décidément rien à sauver dans la débauche.
Or on est en droit de trouver ce schéma narratif critiquable. Un brin réactionnaire : pour le même prix, Suzanne pouvait être heureuse. Oui mais voilà, papa est trop fort, et une sexualité débridée ne peut être que le signe d’une blessure profonde. Enfin, l’incapacité à vivre et faire l’amour avec l’être qu’on aime parce qu’on l’aime trop, est, disons-le, un sacré cliché ; en tout cas davantage une problématique masculine. Sur ces points-là le récit me paraît un peu douteux.
Certains dialogues du film sont très bons, mais pas tous. Enfin, les disputes familiales, aussi réalistes soient-elles (je sais que Maurice Pialat laissait longtemps tourner sa caméra pour voir les acteurs arriver à certaines extrémités. Ainsi, après des heures de promiscuité passées dans le but d’inventer du vrai, de produire quelque chose en reproduisant des parcelles de vie, la frontière entre jeu et réalité s’en trouve brouillée) frôlent l’hystérie collective. Un peu comme dans les films de Cassavetes, la mysogynie en plus. Le rôle de la mère est ainsi particulièrement ingrat. Sans parler du frère, dont il est sous-entendu qu’il a choisi de cacher son homosexualité pour se marier avec une femme riche et influente dans le but de faire carrière.
Pour autant la force du film n’est pas à remettre en question. De chaque scène se dégage une grande intensité. En le voyant j’ai pris la mesure de ce que des réalisateurs comme Bruno Dumont, ou même Arnaud Desplechin revu récemment lui devaient. Intérêt donc, mais partiel. Le film est malgré tout trop amer, rembruni. Quasi atrabilaire.
En revanche du Garçu il faudra retenir les scènes, toutes magnifiques, entre Gérard et le petit Antoine. La façon qu’a ce père de crever d’amour pour son fils, ses gestes étouffants, comme générés par bouffées d’affection, sont poignants.
Cette fois c’est le personnage masculin qui n’est pas épargné, même si l’on pourrait considérer le départ de sa femme comme le résultat de sa faiblesse et de son incapacité à s’accommoder d’un homme au caractère bien trempé – le personnage de Gérard montre de gros défauts, mais aussi une puissance individuelle hors norme. Je trouve cet homme plutôt aimable, alors pourquoi ne le serait-il pas également aux yeux de Pialat ? Sophie, elle, lui préférera un homme plus effacé, plus féminin et plus gentil ; peut-être plus enfantin puisqu’il prend un chocolat chaud pour son goûter quotidien et refuse d’aller chez le dentiste.
Il est possible que je garde quelque chose de ça, cet attachement mal dosé, pour l’un de mes personnages. Cependant, on peut sérieusement douter que le papa mordu de sa progéniture dans Le garçu le fût tout autant s’il n’en avait pas été séparé. Son amour démesuré vient aussi du sentiment de dépossession. Mon personnage, lui, vit avec son fils. Il se coltine le quotidien d’un père présent.