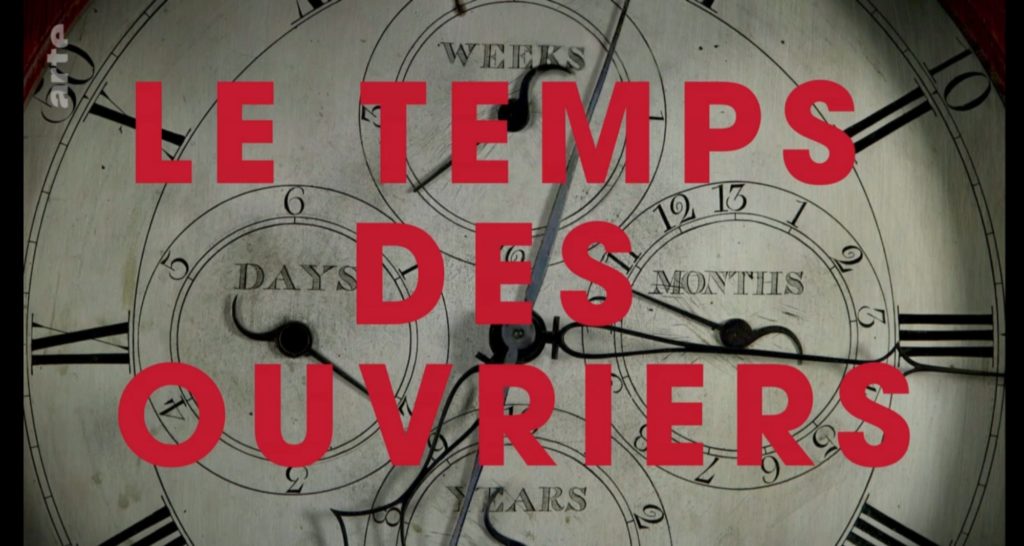Mardi 1er novembre
Je regarde Roubaix, une lumière. Découvre Roschdy Zem et sa classe absolue. Le mélange de douceur et d’obscurité qui émane de lui, et que je ne crois pas avoir jamais vu chez un autre personnage de cinéma. Là très exactement s’invente quelque chose.
L’une des deux meurtrières est jouée par Sara Forestier, méconnaissable. Elle finit par sortir de sa bicoque, avec l’allure d’une pauvre petite chose, avec sa toute petite tête et un pull trop grand. Elle est laide, à la limite de la débilité. Son jeu surtout au début m’impressionne, quand seul se tient, hébété, ce triste corps sans épaules.
Léa Seydoux qui incarne l’autre meurtrière est égale à elle-même. Joliesse étrange, cerclée de cernes (de film en film, Desplechin montre une prédilection pour les yeux globuleux), regard fermé, débit qui mitraille, larmes abondantes. Comme d’habitude Seydoux joue bien et mal en même temps. En premier lieu elle ne joue pas très bien, mais à force d’audace et d’incessante affirmation de son jeu, crée des effets de vérité. C’est en s’imprégnant de l’assurance de l’actrice – une sorte de volonté vorace – que son personnage gagne en incarnation.

Je m’étonne d’une scène où, en brassière et bras nus, la jeune femme qu’elle joue, une junkie, sans instruction et qui se sait foutue, dégage un charme soudain. Quelque chose de sexy. Je ne comprends pas ce que ça vient faire là. Puis, au fil de mes recherches sur le film je saisis ce qu’il en est vraiment : les deux femmes ont existé. Elles existent et le meurtre a eu lieu. Chaque scène, chaque posture, chaque mot a été ramené d’un documentaire (Roubaix, commissariat central) au film. Dans le documentaire la jeune femme porte une brassière identique.
Embarquée presque malgre moi dans son visionnage sitôt après le film, je continue à saisir : Desplechin a voulu bien distinguer les rôles. Surtout qu’on ne s’y trompe pas. On y trouvera comme au dessus des hommes le commissaire Daoud, grand et généreux ; d’un côté la meurtrière stupide et sans charisme ; et de l’autre la plus dégourdie, belle et manipulatrice. Belles, dans la réalité les criminelles le sont toutes les deux. À les voir pendant l’interrogatoire on les imagine facilement ensemble. On se figure leur vie, se déroulant à deux, dans une routine d’ennui ; leur quotidien sordide et complice.
En vérité les femmes, chacune à sa manière dégagent une égale complexité. L’une parle beaucoup, l’autre ne cède des bribes d’informations que lorsqu’on lui rappelle son petit garçon qui l’attend. On la voit alors presque sursauter sous la piqure. Souvent les deux regardent leurs interlocuteurs droit dans les yeux.
Dans le film les policiers qui mènent l’interrogatoire crient beaucoup derrière Daoud l’impérial. Jamais dans le documentaire. La tension cependant s’y avère plus forte. On voit les deux femmes se retrouver peu à peu acculées. On sent l’espace pour elles se rétrécir. Elles tournent en rond. Finissent par céder : l’une sous la rapidité des questions qui ne la laissent pas tergiverser, l’autre de manière plus tranquille, plus lancinante, par le chantage au fils. Ici, pas d’interprétation psychologisante du commissaire (d’ailleurs les policiers interviennent successivement, indistincts et sans grade). L’horreur se déplie dans sa grande banalité. Une banalité qu’aucune fiction ne me semble pouvoir capter. Tout sonne juste. Tout fascine. C’est le réel.
Note : pour prolonger, ici, un autre billet sur le cinéma d’Arnaud Desplechin.