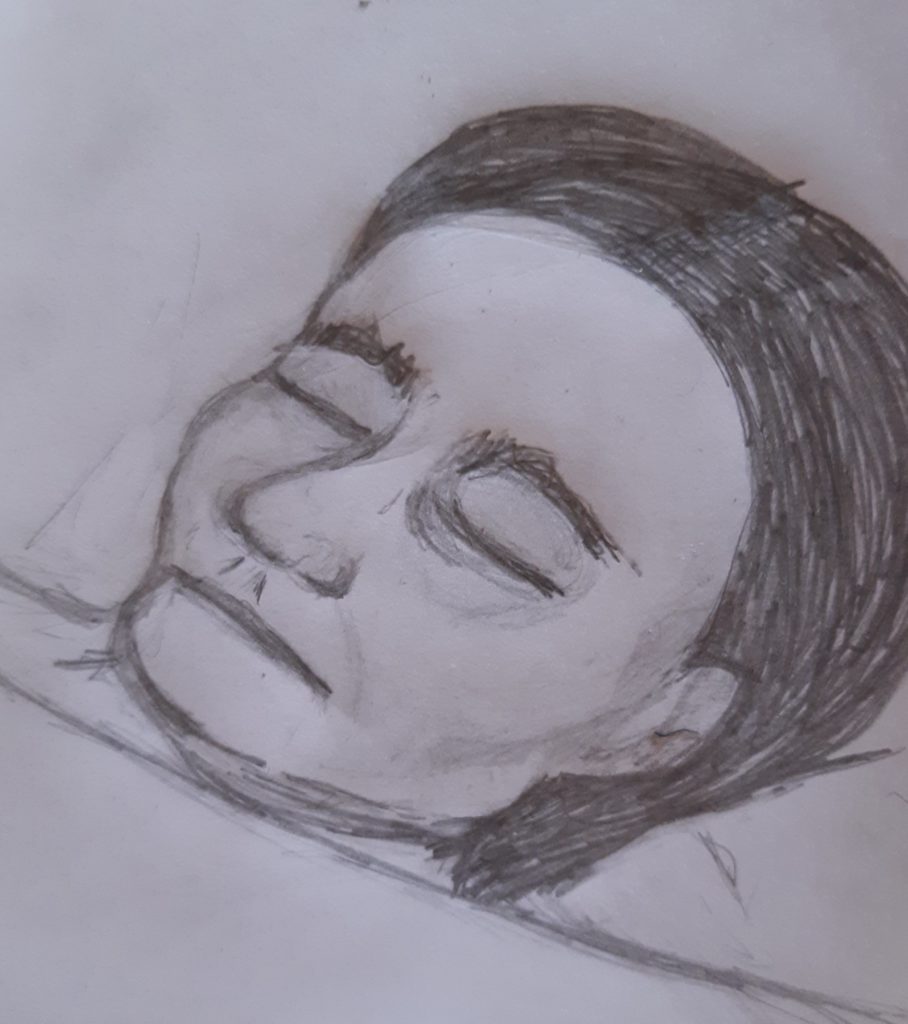Mercredi 23 mars

La strada : ce classique que j’ai découvert hier éclaire le récent Licorice pizza que je n’avais pas aimé. Il m’explique un peu mieux pourquoi je suis comme restée sur ma faim tout au long du film de Paul Thomas Anderson. Certes, les deux oeuvres ont des ambiances et des tonalités radicalement différentes (l’un d’ailleurs finit bien, l’autre mal). Mais dans les deux cas il est question de compagnonnage amoureux et de sentiments inavoués, y compris à soi-même. Et alors que le film de Federico Fellini parvient à monter en intensité jusqu’au déchirement final de Zampano, le PTA m’a semblé patiner pour les raisons que j’ai déjà expliquées. Mais il est frappant de voir chez Fellini comme l’économie de moyens et la simplicité du récit permettent justement de donner toute sa place à l’histoire d’amour, à la faire gonfler et s’écrouler sur elle-même à la fois, à faire que chaque geste, chaque parole soit un possible sans cesse avorté. Dans La strada on retrouve le traditionnel triangle amoureux (mari, femme, amant) mais étrangement (et alors, quelle trouvaille !) sans le sexe. Quelque part, là où le sentiment se contente de frémir, on atteint l’os.
En effet, dès lors que le trio se fige se constitue également un réseau de potentialités. Mais c’est ce nouvel état des choses et des êtres, leur ouverture totale aux possibles qui ne laissera plus prendre aux personnages que de mauvais virages. Summum de cruauté, quand tout semble envisageable tout concourt au malheur. Des trois protagonistes, seul Zampano restera, mais dévasté car il est l’unique responsable et de la mort des deux autres, et de sa solitude. La force du film est que dans le récit, le possible seul parvient à faire naître l’espoir (celui des personnages comme du spectateur), naître l’amour de Gelsomina pour Zampano autant, ou presque, que pour « Le Fou » (Il Matto). Et peut-être aussi l’amour de Zampano pour Gelsomina. En même temps, les péripéties viennent sans cesse décevoir cet espoir ; elles le brident toujours un peu plus.
Jusqu’au bout, un miracle (une déclaration de Zampano, les retrouvailles du couple) est attendu, autant qu’est redoutée une catastrophe (difficile par exemple de ne pas craindre pour la vie de Gelsomina quand Zampano constate que désormais totalement folle, elle ne cessera de l’accuser entre deux exclamations joyeuses). Et de fait, si la catastrophe n’arrive pas là où on l’attendrait (malgré les signes habilement distribués par le réalisateur, Zampano pas plus qu’Il Matto ne se tue en faisant son périlleux numéro), elle finira bien par nous surprendre (Zampano vole éhontément des coeurs en argent chez les bonnes sœurs qui l’ont accueilli ; Il Matto meurt sous deux coups de poings inoffensifs ; enfin, on apprend que Gelsomina est morte au moment même où l’on entend son air fétiche). Comble du malheur, dans la dernière scène, Zampano ne se suicidera pas en allant se jeter ivre mort dans la mer. Au lieu de cela il réalisera, lamentablement échoué sur le sable, qu’il a définitivement perdu la femme qu’il aimait. En lui survivant il se condamne ainsi à une existence de désespoir et de remords.
Quel lien avec Licorice pizza ? Rien, si ce n’est cette attention portée au possible, le maintien du cœur du récit, ce qui le met en mouvement – la rencontre amoureuse – à sa lisière. On pourrait y voir le sujet même des deux films. Son traitement, cependant, s’avère à l’opposé chez les deux réalisateurs. Avec, donc, des succès divers. La profusion, non : la saturation des signes chez PTA limite l’imaginaire là où le maître italien, par une économie d’effets particulièrement savante, particulièrement maîtrisée, fait exploser comme j’ai essayé de le montrer plus haut, les intensités d’affects et leur expression.
Ce constat rejoint plusieurs de mes réflexions récentes (sur l’excès, là encore, de signes dans le dernier roman de Bégaudeau, ou encore la soustraction puissante dans The Lobster de Lánthimos). Peut-être faut-il voir là deux écoles distinctes, ou du moins deux esthétiques, chacune sans doute avec ses qualités propres : celle qui noie pour laisser affleurer, par touches, l’élan caché ; et celle qui ne cesse d’épurer pour le faire deviner plus aisément. Mais pour ce qui est du jeu des possibles, en ce moment Lánthimos et Fellini (en tout cas dans ce film-là, car on le connaîtra moins sobre), font pour moi modèle. Ils le font d’autant plus que je suis, spontanément, de ceux qui en font trop.