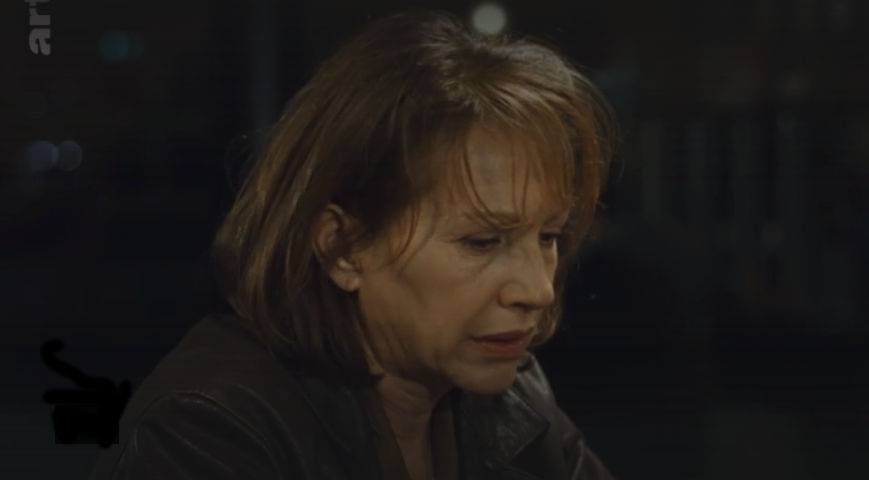Dimanche 11 juillet
J’ai récemment regardé The Lobster de Yórgos Lánthimos, attirée par Colin Farell, que j’avais découvert peu de temps avant dans un film fantastique intitulé Mise à mort du cerf sacré (1). Car avant ce film, de cet acteur je ne connaissais à peu près rien, disons même je ne lui trouvais à peu près rien de notable, si ce n’est une vague ressemblance avec Xavier Bertrand et une fâcheuse tendance à jouer dans des films hyper-commerciaux pour lesquels il n’avait pas le physique adéquat (Minority Report, Alexandre, Miami Vice). Mais Mise à mort… avait pulvérisé depuis tous mes a priori, tant le jeu de l’acteur y apparaissait à la fois sobre et intense. Et comme rien n’est plus agréable que de passer de l’indifférence, voire de l’antipathie à l’admiration, je me suis laissée aller à cette dernière avec un plaisir non feint.
Ce que je ne savais pas, c’est que The Lobster et Mise à mort… sont du même réalisateur. Je ne l’ai compris qu’à la toute fin de The Lobster, pour une raison sur laquelle je reviendrai. Pourtant, dans les deux films, le ton et le rythme sont très proches, donnant le sentiment que l’absurde est inexorable. C’est je crois un trait majeur du cinéma de Yórgos Lánthimos. Le propre de l’absurde est de montrer que les choses sont ainsi mais qu’elles pourraient tout aussi bien être différentes. L’absurde est le lieu de la gratuité, de l’illogisme (ou de l’a-logisme), il affirme que rien ne justifie que le récit et ses circonstances s’agencent de cette façon. Mais il acquiert une puissance particulière lorsque de l’absurde naît son inverse, à savoir le sentiment de la fatalité. Or, Yórgos Lánthimos le fait d’une manière originale et absolument déroutante : il ajoute de l’absurde à l’absurde.

Le réalisateur fait ainsi dévier son propre dispositif narratif (absurde au premier degré) en introduisant d’autres éléments incohérents à cette trame de départ (absurdes au deuxième degré). Par exemple, dans The Lobster, le héros David a rejoint les Solitaires dans la forêt où il faut toujours rester aux aguets. Il s’entraîne quotidiennement, car au sein du groupe chacun lutte pour sa survie. Or, on voit la femme dont il est tombé amoureux, rendue aveugle par la cheffe du groupe, l’attendre régulièrement, peut-être longtemps, immobile sous un arbre. Chez les Solitaires toute marque de tendresse est proscrite, les sanctions envers ceux qui y cèdent sont épouvantables, et pourtant, la jeune femme peut bien demeurer au même endroit et attendre la visite de David en toute tranquillité. Évidemment, à ce moment-là, celle-ci est devenue une figure, un être-là-pour-suivre-sa-destinée, équivalent de Hamm, Nell et Nagg de Fin de partie ! de Samuel Beckett. Comme eux elle n’agit plus mais est agie. Il fallait ce petit décalage dans le récit pour que la condition de chacun devienne, cette fois, tout à fait patente. La puissance tragique qui opère s’en trouve dédoublée. Tout pourrait être différent, on le sent en permanence, mais dès le moment où le récit a pris tel tour, puis tel autre, ou bien tel autre (les contradictions pouvant se superposer) les personnages n’auront aucun moyen de se soustraire à l’issue qui les attend déjà. Le piège s’est fermé sur eux dès que les circonstances de l’histoire, quoique arbitraires, indifférentes et totalement loufoques, ont été posées.
Et malgré le comique de nombre de situations, cette issue est de l’ordre du sacrifice, d’une perte que le héros finit lui-même par désirer. Il sacrifiera quelque chose qui lui est cher, évidemment. Mais là encore peu importe quoi exactement, l’essentiel n’étant pas tant dans la nature du sacrifice que dans l’acte sacrificiel. C’est cet élément qui m’a fait réaliser la paternité commune aux deux films. Il n’y a plus d’autre choix que de donner (son fils, peut-être ses yeux, peut-être son amour, comme l’ont fait Médée et Oedipe). Donner, mais à qui ? On s’en doute, chez Yórgos Lánthimos ne se trouve nulle trace de dieux demandant vengeance pour rétablir un quelconque équilibre. Résumons : donner quoi, peu importe, à qui peu importe, poussé par quelles forces, peu importe. Mais donner irrémédiablement.
Yórgos Lánthimos est souvent critiqué pour son cynisme. Il me semble qu’il est tout le contraire d’un artiste immoral (a-moral) ou désabusé comme j’ai pu le lire, et ce n’est pas parce que ses personnages laissent peu couler leurs larmes que l’émotion est absente de ses films. L’amour qui pousse David à fuir les Solitaires avec la femme aveugle est d’une force rare au milieu de l’horreur froide qui les entoure. Ce contraste qui va s’intensifiant rend magnifique toute la dernière partie. On ne saura pas si le héros parviendra à s’aveugler et se rendre ainsi « compatible » avec sa bien-aimée aux yeux de la société, mais rien ne fera que cet amour n’aura pas été. Il est vrai, et c’est sans doute cela qui semble si inacceptable, que ce ne sont pas tant les sentiments humains qui structurent les comportements que le caractère lui-même totalement gratuit des règles (l’expression est, de fait, étrange) qui les déterminent. Quand on évolue dans un monde dominé par l’absurde, les logiques que l’on suit – aussi solides semblent-elles – obéissent en réalité tout autant aux lois de l’arbitraire. Le miroir tendu par Yórgos Lánthimos a de quoi faire trembler, peut-être vaciller. Remuer, indéniablement.
(1) Ce film m’avait tellement marquée que lors de ma lecture récente de De sang froid, la scène du crime familial de 1959 s’était déroulée dans ce dont je me souvenais du sous-sol aménagé de la maison contemporaine de ses personnages principaux.