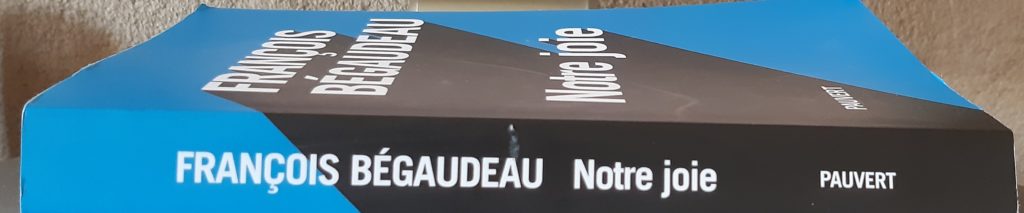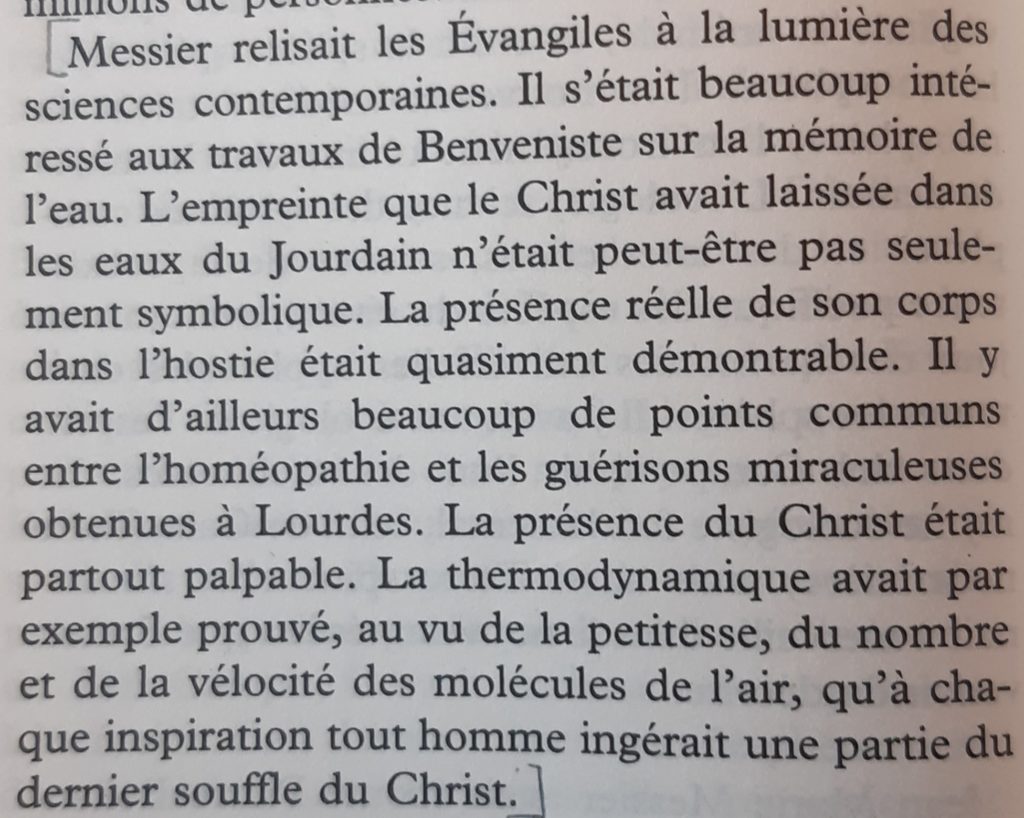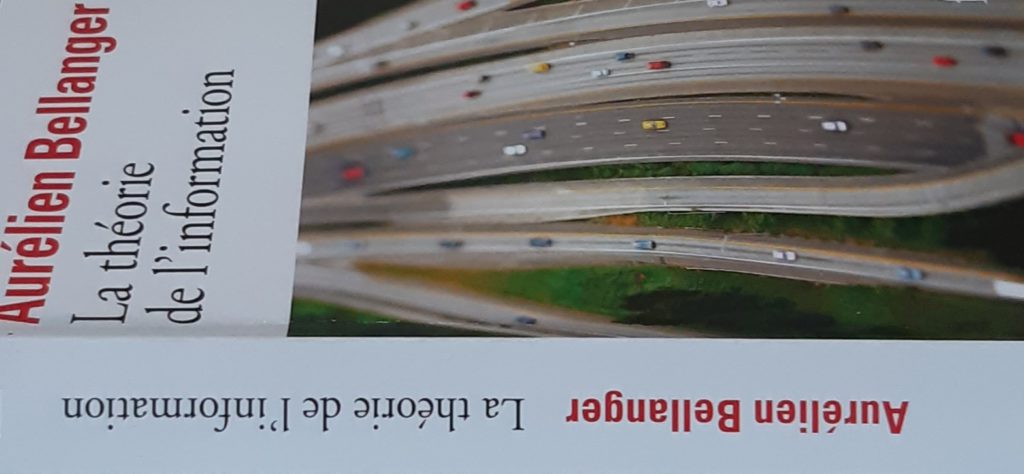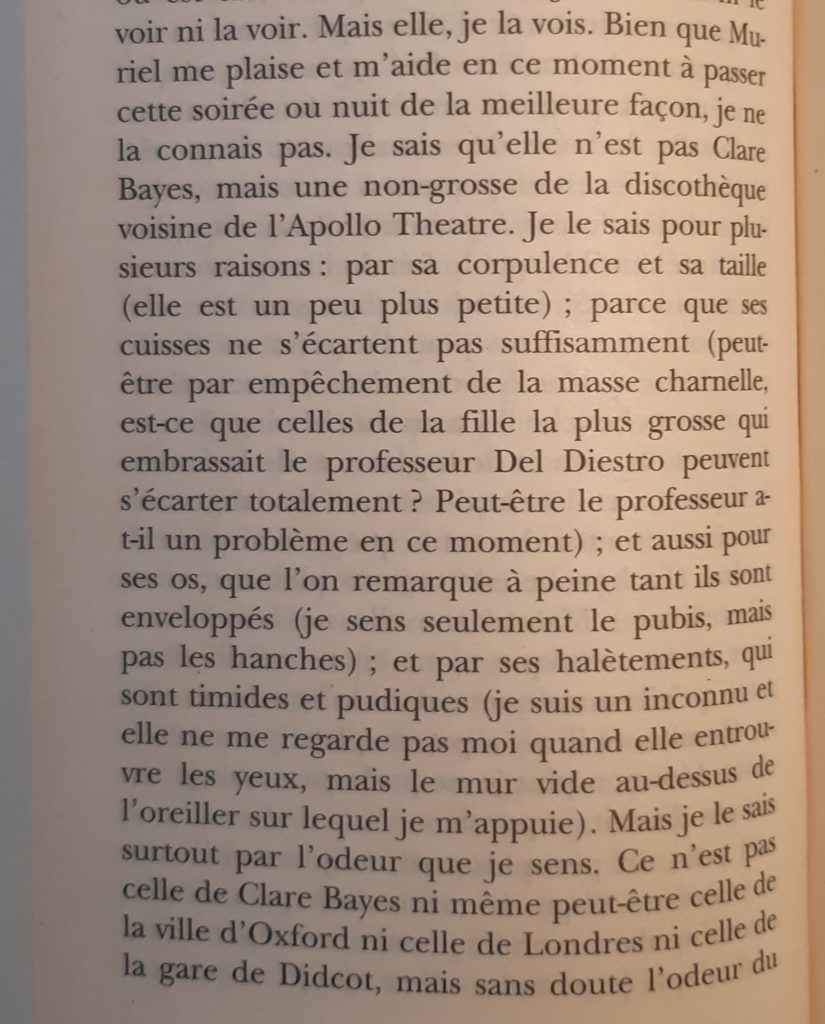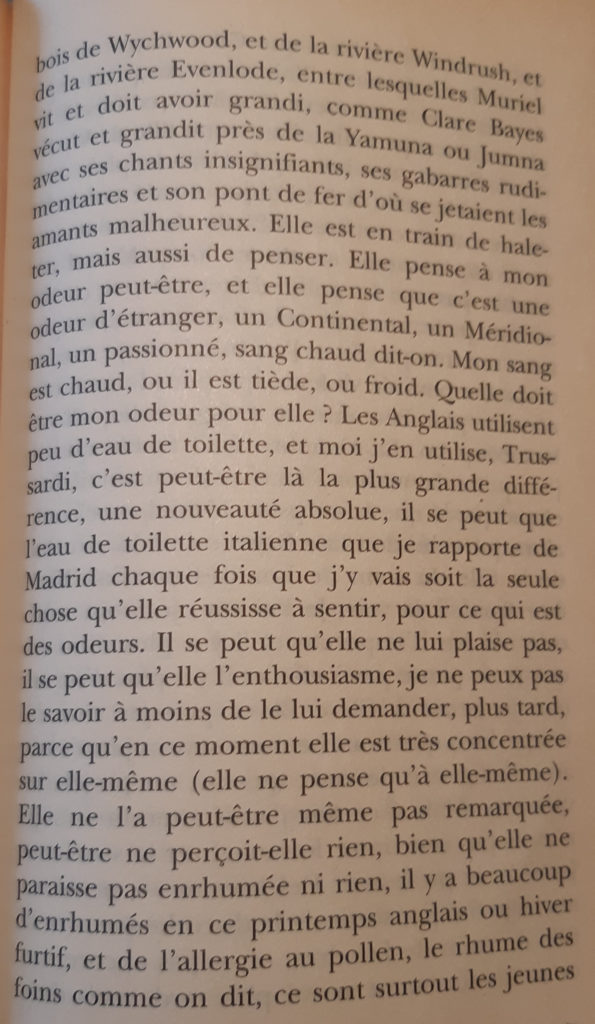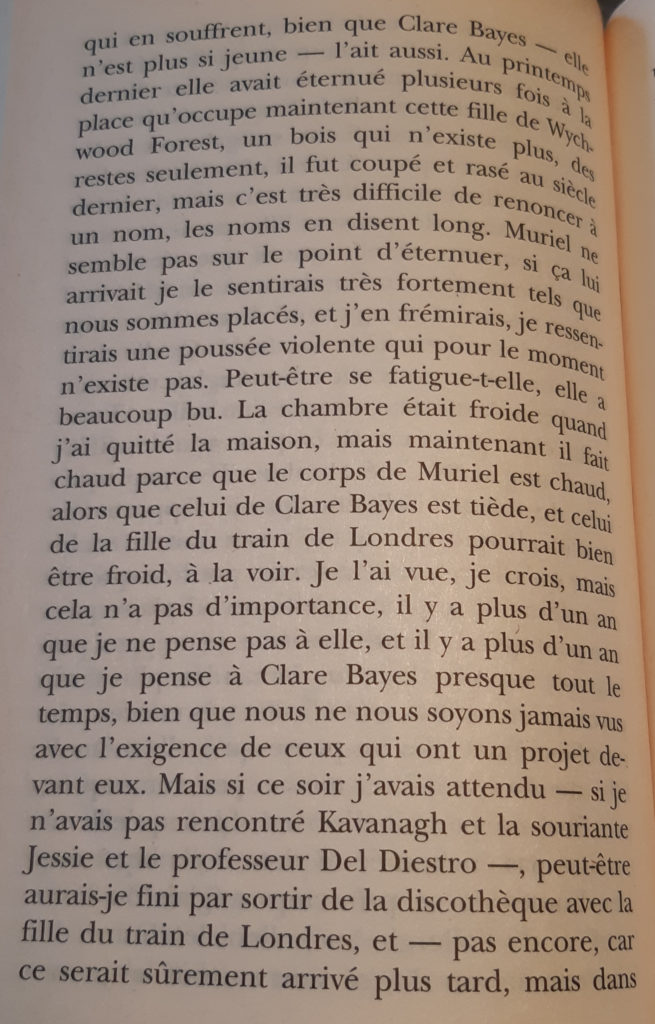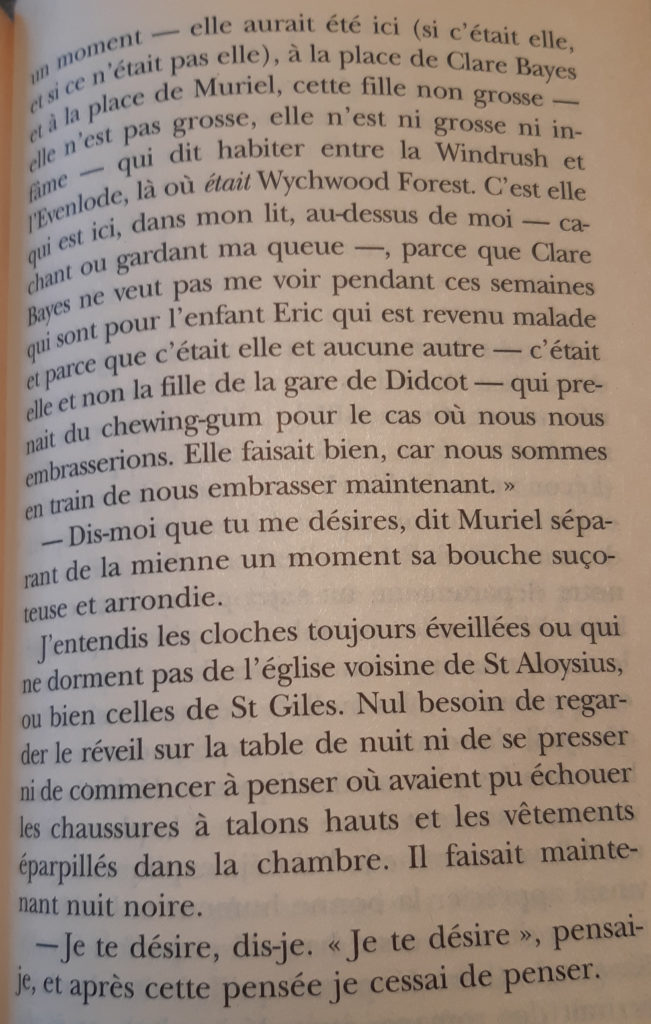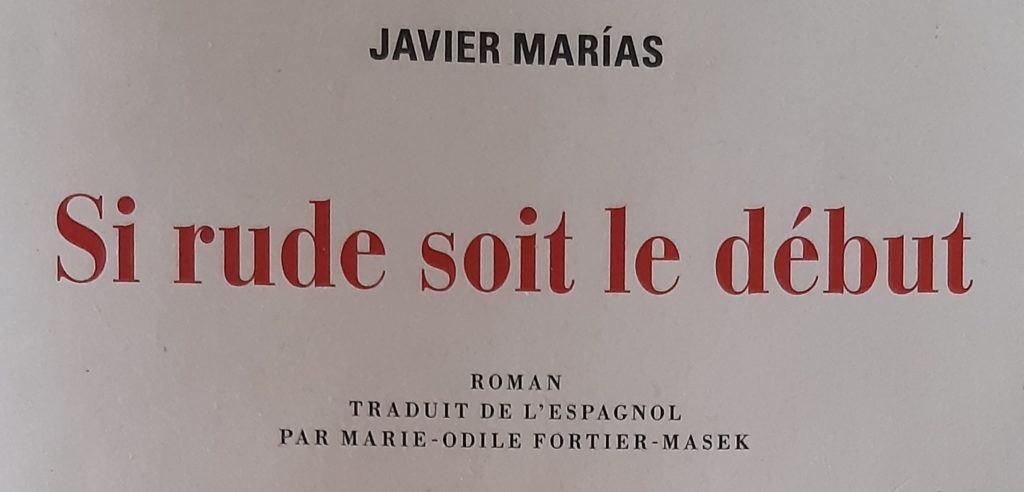Dimanche 12 décembre
Avant d’être son amoureux j’avais été son patient. Du jour au lendemain j’avais ressenti de vives douleurs entre la clavicule gauche et la base du cou. Elles me ravageaient en un instant, tels des obus venant crever la terre. Parfois au milieu du jour, parfois – et c’était alors plus simple, la perspective de ruine que serait ma journée ne me laissant dans ce cas aucun vain espoir -, au saut du lit. Au travail je dus me porter pâle plusieurs jours d’affilée. Revenais quelques temps. Puis le cycle de douleur reprenait. Pendant quelques semaines je jonglai tant bien que mal en rattrapant à la maison le retard pris au bureau. À ce rythme très vite je n’eus plus de vie mais faisais semblant de la maintenir à flot. C’est étrange de tenter de sauver les apparences. D’empêcher de sombrer ce qui n’existe déjà plus. Cela revient à effectuer des gestes. Pas davantage, mais l’effort est immense. À agir en pantin. Ne plus penser ni ne rien faire qui puisse mettre à mal le principe d’inertie sur lequel tout repose. Alors faire le dos rond serrer les dents croiser les doigts mais pas trop fort pour toujours assurer une certaine fluidité de la circulation sanguine. Surtout pour que ça passe. Car avant tout laisser, laisser tout laisser faire que tout glisse. Et tout à sa tâche essayer à la fois de délier l’imbroglio de chair, de muscles et de fibres sous la peau fixé à l’omoplate. Contractée malgré soi par des décharges électriques. Brèves. Vives. Fulgurantes. Une torture. Délacer, gentiment, que ça saute, calmement, exécution. Dans l’objectif. Dans l’objectif de. Dans l’objectif de faciliter. Dans l’objectif de faciliter le passage douleur-travail. Surfer de la souffrance à la concentration. Cou – pointe de l’os – vice-versa. En bon automate mis sur ressorts, tout ce qui comptait vraiment pour moi à cette époque fut de sauvegarder mon activité professionnelle. Je pense que beaucoup auraient réagi ainsi. Il faut croire qu’aller au turbin est la seule mesure de la capacité – du droit – des hommes à vivre parmi leurs semblables. Si bien que pour être tout à fait honnêtes nous devrions dire « quand le travail va, tout va ». Ou plus exactement : « quand la santé permet de travailler tout va ». Ou bien encore : « quand le travail-c’est-la-santé va tout va ».
Malgré tous mes aménagements les poussées déchirantes finirent par se rapprocher à un point tel qu’il me devint impossible de rattraper les heures de travail manquées. C’est là que je me résolus à aller voir un médecin. Je ressentais une grande honte à déclarer forfait devant l’assaut répété du corps. C’était la première fois que je flanchais. Mais je me sentais flancher pour de bon. Il faut dire à ma décharge. J’avais quelques raisons de ployer sous le fardeau. C’est qu’il m’en faut beaucoup. En général je ne pose pas problème. Je suis un homme discret. J’ai su trouver ma place dans la société. Je comptais m’y tenir. On me dit conciliant. Et en effet je m’adapte à des attentes variées. Dans le monde social comme le professionnel je me plie sans broncher aux exigences de toutes sortes. Je peux agir froidement là où beaucoup s’affolent. Prendre mes responsabilités. Être aimable malgré ma rancœur, c’est-à-dire la cacher. À l’inverse me montrer dur même sans ressentiment si la situation l’exige. Rester stoïque devant l’incompétence ou bien taper du poing. Indifféremment. Voire alterner : jouer avec les nerfs de l’interlocuteur s’avère souvent payant. Je sais faire ce qu’il faut. N’ai aucun tabou. Peu de moralité. Cependant. Une chose pourrait me faire perdre mon sang-froid. Me rendre et pourquoi pas violent. Cette chose est l’accumulation de tâches insipides – la succession des obligations absurdes – le tunnel – comme il m’arrive encore de devoir en traverser par période – et Dieu soit loué par période seulement – malgré tous les efforts que j’ai faits pour me fabriquer sans relâche une vie la moins contraignante possible. Cette chose est le bain bouillonnant d’urgence et de l’ennui. L’inanité pressante me brûle de l’intérieur tel l’enfer sous la terre. Or ces périodes existent. Elles sont incompressibles. Elles finiront par avoir ma peau.
Dans ces circonstances j’avais trouvé un recours qui agit longtemps comme une consolation : je déjouais le déroulement attendu des tâches. En invertissais l’enchaînement. J’y mis finalement autant d’énergie qu’à effectuer lesdites. Ainsi je trompais mon monde en opérant en permanence de légères distorsions. Quelle sensation de liberté, fugace et délicieuse ! J’appelais le percepteur dans les embouteillages. Faisais réparer la fuite dans la salle de bain à la caisse du supermarché. Effectuais mes achats de Noël au bureau. Écrivais mes cartes de vœux pendant les réunions de mes fins de journée. Terminais le traitement d’un dossier sous la couette tout en matant des films. Que faire d’autre ? Jusque-là ces petits arrangements avaient suffi et les périodes de tension étaient assez courtes pour que je m’en sorte avec tout au plus une vague mauvaise humeur quand je me trouvais dehors et une envie nocturne de me tirer une balle. Puis, avec le retour à la normale, tous ces tourments tombaient aux oubliettes. La douleur s’efface de la mémoire dès lors que disparaît sa cause. Finies alors l’angoisse, la morosité, les pulsions et la hargne. Je retrouvais ma bonhomie jusqu’à la fois prochaine.
Mais la perversité de notre condition tient à ce que faire à l’envers est faire tout de même. On a beau mettre en place des mécanismes de confort – ou de survie – de quelque chose entre le confort et la survie – de conservation de l’être, on n’est jamais tout à fait sauf. Le sentiment d’affranchissement reste dérisoire. Illusion, même. Et arrive un moment où l’on ne sait plus vraiment si en opérant une subversion farouche des contraintes l’on n’est pas en réalité en train de s’en rendre plus esclave encore. D’une façon ou d’une autre, chaque moment est dévoué à l’action. Il faut se rendre à l’évidence. À la fin c’est bien l’efficacité qui prime. Qui gagne. Les missions ont toutes été accomplies. On a bouclé le dossier dans les délais. Le neveu a sauté de joie en découvrant la dernière console qu’on lui a dégotée (mais comment a-t-on fait ? elle était pourtant en rupture de stock depuis des semaines). Le client est satisfait. L’assurance a couvert les frais dus au dégât des eaux chez les voisins du dessous. On est salué pour son sérieux. On a évité la majoration d’impôt. Et l’on tombe malade. Y a-t-il d’autre choix ? Quelle est l’alternative ? On peut toujours s’échiner à changer d’habillage la déferlante d’obligations inhérentes à l’organisation en collectivité, elles n’en resteront pas moins fades à crever. Lorsque je me suis décidé à consulter, j’étais juste dans l’œil du cyclone depuis un peu plus longtemps que d’habitude. Oh pas grand-chose. Deux ou trois semaines de plus que les temps de rush ordinaires voilà tout. Mais il faut croire que ces quelques jours étaient de trop. J’en avais plein le dos, comment le dire autrement ? Il faut bien accepter le réel comme il nous tombe dessus. Le docteur me reçut. M’examina sans me toucher. Prescrivit des cachets. Griffonna une lettre. M’envoya vers une collègue. Une spécialiste me dit-il. Élodie.