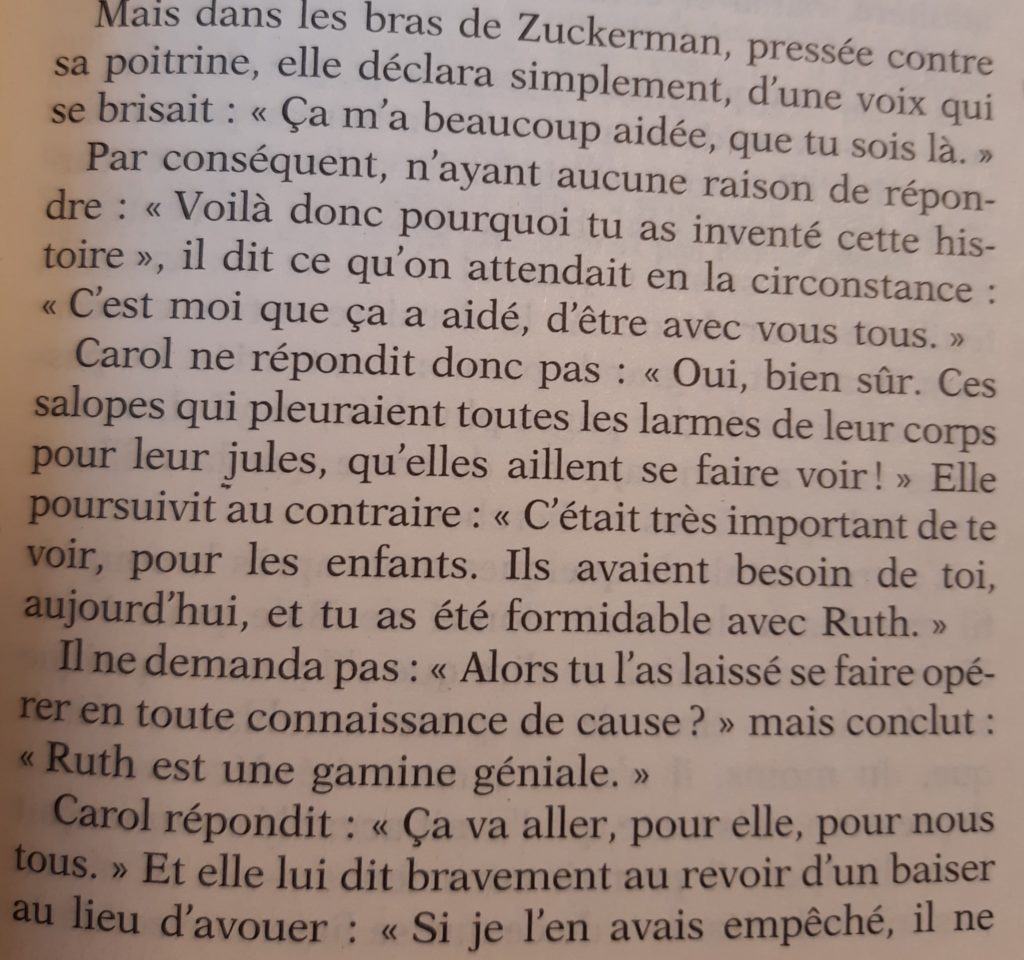Dimanche 17 avril
Dans le commentaire d’un spectateur de l’émission Hors série de ce samedi portant sur la question de l’abstention, je lis :
L’obsession de la moisson et l’indifférence à l’histoire sont les deux extrémités de mon arc.
Je suis très reconnaissante au commentateur de m’avoir fait découvrir ce vers de René Char. Il dit en trois mots comme le labeur d’écriture s’impose au poète : dur, tendu, quotidien. Un labeur dont il ne faut en aucun cas se laisser détourner. Dans ces conditions, les questions plus abstraites, les phénomènes collectifs, la formation de l’histoire – l’histoire « avec sa grande hâche » aurait dit Perec – ne peuvent plus être une préoccupation pour l’écrivain. Il n’y a plus place en lui.
Ce vers est sublime. Cependant, après réflexion il ne me semble pas tout à fait coïncider avec la pensée de F. Begaudeau telle qu’il la développe lors de l’émission du 16 avril. Je ne crois pas que l’auteur soit indifférent à l’histoire, mais plutôt au fonctionnement de la société et des institutions qui l’ordonnent. Indifférent aux institutions, fondées sur le jeu politique, fondé sur la recherche de la prise de pouvoir elle-même fondée sur les rapports de force.
Ce que les militants ne semblent pas comprendre – pour des raisons louables, mais qui les condamnent à un dialogue de sourds avec ceux qui se retirent volontairement des enjeux électoraux – c’est qu’on peut considérer que le véritable pouvoir consiste à ne pas chercher à l’obtenir. On peut désirer ne pas combattre, non par indifférence, paresse ou lâcheté, mais parce que seul compte de diriger son énergie et son temps vers l’amour de la vie.
Les militants, qui sont souvent eux-mêmes des retraités ou bien des gens installés dans un confort petit bourgeois (comme je le suis, culturellement du moins : ce n’est pas un jugement de valeur mais un constat objectif ; je reviendrai sur ce point) adorent opposer que les plus précaires, eux, n’ont pas de temps pour profiter de loisirs ; qu’ils ne peuvent pas se permettre de se laisser écraser par le capitalisme ni, plus concrètement, exploiter toujours davantage par leurs patrons. La tranquillité d’esprit serait donc un luxe.
J’affirme au contraire que la capacité à profiter de son temps, à aimer sa vie et à connaître la joie au quotidien n’a aucun lien avec les conditions sociales d’existence. Cela ne signifie absolument pas qu’on ne doive pas se battre pour améliorer ses conditions de travail ou lutter pour le partage des richesses, mais qu’il est possible pour une femme de ménage, pas moins que pour un cadre supérieur, de connaître le plaisir de laisser couler le jus d’une pêche le long de son cou (1). Ce que le capitalisme nous vole, ce n’est pas le temps ou l’accès à des activités aimables, mais l’envie, ou plutôt la force intérieure de s’y adonner. Ce que la société nous ôte c’est notre propre jus.
Une société non fondée sur le profit et qui ne fasse pas de l’emploi un indicateur de valeur personnelle serait évidemment le meilleur moyen de garantir à chacun une existence pleine et paisible. C’est cette certitude qui fait de nous des anticapitalistes.
Pour autant, en attendant et faute de mieux, il reste possible de trouver des failles dans l’existant. La faille consistant toujours à s’extraire de tout commerce, au sens propre du terme. Ne peindre les plus défavorisés que comme des défavorisés est un mensonge, une facilité. Si je militais pour ma propre chapelle je dirais que c’est même une insulte. Le monde occidental n’est pas divisé entre les très riches heureux et les pauvres malheureux (attention : je ne viens pas d’écrire qu’il n’existe pas, en France y compris, de pauvres malheureux pour des raisons sociales). L’immense majorité barbote au milieu, avec des avantages et des difficultés, des RTT et des crédits, ainsi que le sentiment très juste que remplir son caddy coûte de plus en plus cher. Mais surtout, et c’est cela qu’il faut aussi entendre, cette majorité, au même titre que les riches et les pauvres, doit se battre au quotidien pour sauver sa propre aptitude à se satisfaire de richesses qui n’ont rien à voir avec l’argent.
J’affirme également que le nombre de trahisons et de reniements nécessaires à la prise de pouvoir par la gauche ne peut que la faire passer de l’autre côté de ce qui est censé faire d’elle « la gauche ». J’ai déjà esquissé une réflexion – enfin, un mouvement d’humeur – à ce sujet il y a quelques jours. Mais le fait que, tout en s’affolant de la menace fasciste et des taux d’abstention on soit déjà tout occupé à faire fructifier son hégémonie nouvelle et à diriger en leader absolu des transactions (oui) avec ceux qu’on conspuait il y a encore deux semaines en vue des législatives, a à mes yeux quelque chose de profondément – profondément – problématique.
Mais bien sûr, se présenter à des élections que l’on sait perdues d’avance en entraînant dans sa défaite ceux de son camp qui auraient pu les gagner n’est guère mieux. Dans tous les cas, on le voit, ce qui fait exister les forces de gauche est dans le même temps ce qui la fait perdre. La politique politicienne fait tourner la tête à bien du monde. Plus précisément, les enjeux, en devenant électoraux perdent leur caractère noblement politique. De ce point de vue également, la politique se désintègre dans l’élection. On pourrait dire aussi : l’élection est de droite. Celle-ci n’est en effet rien d’autre que l’autorisation ponctuelle donnée au groupe (un parti, un mouvement) de se laisser aller à la pulsion d’écraser ce qui diffère de lui.
À partir de là, il est permis de refuser, très simplement, en conscience comme aiment tant à dire les électeurs éclairés dans une sorte d’homélie douteuse, de participer à ce qui ne peut être qu’un piège. Cela ne fait pas de nous des bourgeois, indifférents aux autres ou à l’état du monde. Cette accusation systématique s’avère d’ailleurs assez insupportable, car elle veut faire taire en décrédibilisant. Tout cela, au contraire, détermine à agir là où on le peut, à faire par exemple que les relations avec les autres soient fortes et belles, que nos occupations, individuelles, collectives, professionnelles ou associatives demeurent joyeuses, aussi éloignées que possible de l’obsession des hiérarchies et de la rentabilité.
D’aucuns, je le sais, trouvent ces actes dérisoires au regard de la prise du pays par les voies électorales, pourtant sans cesse repoussée pour une raison ou une autre. Ces actes sont au contraire d’une importance majeure. D’une grande puissance car effectués hors – et souvent en dépit – des institutions. Ils existent ici et maintenant, loin des stratégies tordues et des spéculations sur un futur qui n’arrive jamais. Simplement ils s’effectuent à bas bruit. Ne font pas la une des journaux. Ne se traduisent pas par une avalanche de tweets. N’alimentent pas le feuilleton. Ils échappent à cette autre plaie de l’époque, fruit et nourriture du capitalisme qu’est la quête permanente de la médiatisation de soi, l’autopromotion qui rend à peu près dingues tous ceux qui s’y adonnent.
À bien y regarder, cette dimension-là de la politique s’avère la plus essentielle à tenir et la plus difficile. Elle exige un renoncement profond que l’autre, celle qui se mesure en sondages payés par les agences de communication, ne connaîtra jamais. François Bégaudeau a parfaitement raison : écrire est gratuit. Procure à titre grâcieux de la jubilation. D’innombrables activités de ce type existent. Elles sont la vie même, son sel. Alors certes, nous ne votons pas. Grand bien nous fasse : l’abstention est une saine routine.
(1) cf la fin de la discussion dans Hors serie, où la journaliste Louisa Yousfi cite les dernières lignes de Comment s’occuper un dimanche d’élection.