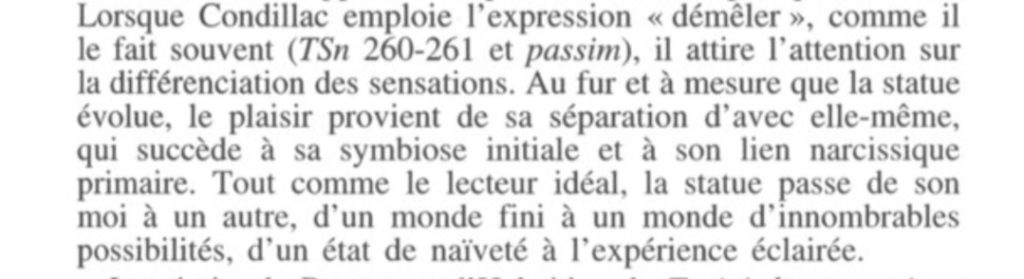Dimanche 2 janvier
Il y a quelque chose que je dois clarifier. Plusieurs choses qui se mêlent en réalité :
1) mon narrateur n’est pas un littéraire. Il ne peut pas avoir un avis aussi tranché sur des auteurs tels que Modiano, Kundera et Vian. Étant ce qu’il est, ou bien il les apprécie comme tout le monde, ou bien il ne les a pas lus. Ce qui revient bien à dire dans les deux cas qu’il n’a pas d’avis sur eux.
2) Après réflexion j’arrive à la conclusion que la seule possibilité pour que le narrateur ait une dent explicite contre eux (même sans la connaissance détaillée d’un grand lecteur) est qu’il leur reproche de faire de la littérature pour nanas. C’est ce que je pense. C’est ainsi du moins que je formulerais les choses dans la vraie vie. Et c’est ce qui m’interpelle. Dans ma tête il existe réellement une catégorie de choses dont la faible qualité est inextricablement associée à l’idée de féminin. Et ce, même si elles sont appréciées par des hommes. Je ne sais pas du tout pourquoi.
Par exemple jusqu’à une conversation récente avec un ami, j’associais les questions du soin et du bien-être à ce féminin-là. Or le fait est que beaucoup d’hommes s’intéressent sincèrement à ces sujets. Déjà nombre d’entre eux prospèrent dans ce business, et plus encore sont à la recherche de la santé et d’une forme de sérénité. C’est en réalité une problématique trans-genres. De même, Modiano me semble apprécié par beaucoup d’hommes, à commencer par ceux, majoritaires dans ce genre d’institutions, qui décernent les prix Nobel de littérature.
3) Ce qui me gêne n’est pas tant que je féminise des pratiques ou des thématiques qui n’ont peut-être pas de raison de l’être, mais que cette féminisation soit au fond péjorative. Je ne suis absolument pas misogyne. Je trouve souvent les femmes plus courageuses que les hommes ; mesure chaque jour la somme des injonctions qu’elles subissent et qui ne visent qu’à réduire leur capacité d’action. Je m’empresse de préciser également qu’il y a à l’inverse un tas de pratiques que je critique parce que je les considère comme typiquement masculines, voire virilistes. Mais je dois reconnaître qu’il y a dans ce que je décrivais plus haut une représentation qui m’est propre et qui m’interroge de plus en plus.
4) J’ai déjà évoqué cette interrogation sur l’existence d’un art genré, sans développer davantage.
5) Je reviens au moins sur la littérature. Je pense que le but de l’écriture est d’atteindre à une forme de neutralité de genre. Ou plutôt une explosion. Ainsi, je n’apprécie pas plus les auteures qui jouent sur une supposée sororité (Delaume, Hegland) que celles qui n’ont de cesse que de se faire passer pour des auteurs masculins (de Kerangal, Lucbert dans une moindre mesure). C’est presque un devoir pour un auteur que de chercher dans l’écriture à devenir aussi bien un homme qu’une femme, tour à tour ou les deux à la fois. Mais également un bébé, une plante ou une bourrasque. Un Palafox. Et c’est un autre devoir que celui de faire vivre cette expérience au lecteur. C’est en fait ce travail sur soi de l’auteur qu’est le travail d’écriture qui permettra cette transmission d’expérience. À mes yeux la littérature va à l’encontre de toute revendication identitaire. Elle en est l’antinomie. Cependant je sais qu’une telle affirmation n’épuise pas totalement le questionnement que j’ai exposé plus haut (ma critique du féminin). Ce sont là deux éléments différents, adjacents mais distincts.