Mardi 14 décembre
121
Dimanche 12 décembre
Avant d’être son amoureux j’avais été son patient. Du jour au lendemain j’avais ressenti de vives douleurs entre la clavicule gauche et la base du cou. Elles me ravageaient en un instant, tels des obus venant crever la terre. Parfois au milieu du jour, parfois – et c’était alors plus simple, la perspective de ruine que serait ma journée ne me laissant dans ce cas aucun vain espoir -, au saut du lit. Au travail je dus me porter pâle plusieurs jours d’affilée. Revenais quelques temps. Puis le cycle de douleur reprenait. Pendant quelques semaines je jonglai tant bien que mal en rattrapant à la maison le retard pris au bureau. À ce rythme très vite je n’eus plus de vie mais faisais semblant de la maintenir à flot. C’est étrange de tenter de sauver les apparences. D’empêcher de sombrer ce qui n’existe déjà plus. Cela revient à effectuer des gestes. Pas davantage, mais l’effort est immense. À agir en pantin. Ne plus penser ni ne rien faire qui puisse mettre à mal le principe d’inertie sur lequel tout repose. Alors faire le dos rond serrer les dents croiser les doigts mais pas trop fort pour toujours assurer une certaine fluidité de la circulation sanguine. Surtout pour que ça passe. Car avant tout laisser, laisser tout laisser faire que tout glisse. Et tout à sa tâche essayer à la fois de délier l’imbroglio de chair, de muscles et de fibres sous la peau fixé à l’omoplate. Contractée malgré soi par des décharges électriques. Brèves. Vives. Fulgurantes. Une torture. Délacer, gentiment, que ça saute, calmement, exécution. Dans l’objectif. Dans l’objectif de. Dans l’objectif de faciliter. Dans l’objectif de faciliter le passage douleur-travail. Surfer de la souffrance à la concentration. Cou – pointe de l’os – vice-versa. En bon automate mis sur ressorts, tout ce qui comptait vraiment pour moi à cette époque fut de sauvegarder mon activité professionnelle. Je pense que beaucoup auraient réagi ainsi. Il faut croire qu’aller au turbin est la seule mesure de la capacité – du droit – des hommes à vivre parmi leurs semblables. Si bien que pour être tout à fait honnêtes nous devrions dire « quand le travail va, tout va ». Ou plus exactement : « quand la santé permet de travailler tout va ». Ou bien encore : « quand le travail-c’est-la-santé va tout va ».
Malgré tous mes aménagements les poussées déchirantes finirent par se rapprocher à un point tel qu’il me devint impossible de rattraper les heures de travail manquées. C’est là que je me résolus à aller voir un médecin. Je ressentais une grande honte à déclarer forfait devant l’assaut répété du corps. C’était la première fois que je flanchais. Mais je me sentais flancher pour de bon. Il faut dire à ma décharge. J’avais quelques raisons de ployer sous le fardeau. C’est qu’il m’en faut beaucoup. En général je ne pose pas problème. Je suis un homme discret. J’ai su trouver ma place dans la société. Je comptais m’y tenir. On me dit conciliant. Et en effet je m’adapte à des attentes variées. Dans le monde social comme le professionnel je me plie sans broncher aux exigences de toutes sortes. Je peux agir froidement là où beaucoup s’affolent. Prendre mes responsabilités. Être aimable malgré ma rancœur, c’est-à-dire la cacher. À l’inverse me montrer dur même sans ressentiment si la situation l’exige. Rester stoïque devant l’incompétence ou bien taper du poing. Indifféremment. Voire alterner : jouer avec les nerfs de l’interlocuteur s’avère souvent payant. Je sais faire ce qu’il faut. N’ai aucun tabou. Peu de moralité. Cependant. Une chose pourrait me faire perdre mon sang-froid. Me rendre et pourquoi pas violent. Cette chose est l’accumulation de tâches insipides – la succession des obligations absurdes – le tunnel – comme il m’arrive encore de devoir en traverser par période – et Dieu soit loué par période seulement – malgré tous les efforts que j’ai faits pour me fabriquer sans relâche une vie la moins contraignante possible. Cette chose est le bain bouillonnant d’urgence et de l’ennui. L’inanité pressante me brûle de l’intérieur tel l’enfer sous la terre. Or ces périodes existent. Elles sont incompressibles. Elles finiront par avoir ma peau.
Dans ces circonstances j’avais trouvé un recours qui agit longtemps comme une consolation : je déjouais le déroulement attendu des tâches. En invertissais l’enchaînement. J’y mis finalement autant d’énergie qu’à effectuer lesdites. Ainsi je trompais mon monde en opérant en permanence de légères distorsions. Quelle sensation de liberté, fugace et délicieuse ! J’appelais le percepteur dans les embouteillages. Faisais réparer la fuite dans la salle de bain à la caisse du supermarché. Effectuais mes achats de Noël au bureau. Écrivais mes cartes de vœux pendant les réunions de mes fins de journée. Terminais le traitement d’un dossier sous la couette tout en matant des films. Que faire d’autre ? Jusque-là ces petits arrangements avaient suffi et les périodes de tension étaient assez courtes pour que je m’en sorte avec tout au plus une vague mauvaise humeur quand je me trouvais dehors et une envie nocturne de me tirer une balle. Puis, avec le retour à la normale, tous ces tourments tombaient aux oubliettes. La douleur s’efface de la mémoire dès lors que disparaît sa cause. Finies alors l’angoisse, la morosité, les pulsions et la hargne. Je retrouvais ma bonhomie jusqu’à la fois prochaine.
Mais la perversité de notre condition tient à ce que faire à l’envers est faire tout de même. On a beau mettre en place des mécanismes de confort – ou de survie – de quelque chose entre le confort et la survie – de conservation de l’être, on n’est jamais tout à fait sauf. Le sentiment d’affranchissement reste dérisoire. Illusion, même. Et arrive un moment où l’on ne sait plus vraiment si en opérant une subversion farouche des contraintes l’on n’est pas en réalité en train de s’en rendre plus esclave encore. D’une façon ou d’une autre, chaque moment est dévoué à l’action. Il faut se rendre à l’évidence. À la fin c’est bien l’efficacité qui prime. Qui gagne. Les missions ont toutes été accomplies. On a bouclé le dossier dans les délais. Le neveu a sauté de joie en découvrant la dernière console qu’on lui a dégotée (mais comment a-t-on fait ? elle était pourtant en rupture de stock depuis des semaines). Le client est satisfait. L’assurance a couvert les frais dus au dégât des eaux chez les voisins du dessous. On est salué pour son sérieux. On a évité la majoration d’impôt. Et l’on tombe malade. Y a-t-il d’autre choix ? Quelle est l’alternative ? On peut toujours s’échiner à changer d’habillage la déferlante d’obligations inhérentes à l’organisation en collectivité, elles n’en resteront pas moins fades à crever. Lorsque je me suis décidé à consulter, j’étais juste dans l’œil du cyclone depuis un peu plus longtemps que d’habitude. Oh pas grand-chose. Deux ou trois semaines de plus que les temps de rush ordinaires voilà tout. Mais il faut croire que ces quelques jours étaient de trop. J’en avais plein le dos, comment le dire autrement ? Il faut bien accepter le réel comme il nous tombe dessus. Le docteur me reçut. M’examina sans me toucher. Prescrivit des cachets. Griffonna une lettre. M’envoya vers une collègue. Une spécialiste me dit-il. Élodie.
120
Dimanche 12 décembre
Une pépite d’or en open-source : l’application Stellarium. Magique.
119 – suite
Samedi 11 décembre
Une journée idéale : écrire, faire du sport – m’arracher les tripes, les gainer. Dans tous les cas : jouer.
118 – écrire
Vendredi 10 décembre
« L’écriture n’est pas affaire de langue, mais de langage ».
Écrire. Aller fouiller dans les structures profondes, les mécaniques qui permettent l’expression humaine (de faits, de sentiments) plutôt que faire fructifier des compétences et un savoir accumulés.
Écrire ne sert rien, aucune cause, aucune langue. Écrire éprouve.
117 – syllogisme
Jeudi 2 décembre
Depuis plusieurs jours ces phrases me trottent dans la tête et je cherche une formule claire, capable de dire ceci :
– toute expérience digne de ce nom acquiert (se charge d’) une dimension mystique
– or il n’est d’expérience que corporelle
– donc toute expérience du corps est d’ordre mystique. Il n’y a pas besoin d’aller chercher ailleurs.
Ces phrases sont importantes. Il me semble que par l’écriture je n’ai jamais essayé de raconter autre chose.
Mais le syllogisme est encore trop long. On serait tenté de conclure par un simple « le corps est mystique ». C’est juste ; tellement que si je pouvais, en écrivant ma formule je ferais se superposer corps et mystique, comme deux couches d’une peinture. Mais il ne faudrait pas que dans cette affaire passe à la trappe le constat que c’est par la sensation que quelque chose – un évènement, une sorte de révélation – peut arriver. Il y a bien nécessité de l’expérience.
Ainsi, et pour être plus exact, il faudrait parvenir à écrire « l’expérience est du corps est mystique » avec la force d’égalisation, plus exactement la puissance d’auto-engendrement de « a rose is a rose is a rose is… « . La phrase fonctionnerait alors comme un kaléidoscope, un terme en engendrant un autre dans une sorte de ronde autosuffisante. Je crains de ne pas être claire. Je tâtonne. Je sèche. C’est très enthousiasmant.
Toute suggestion de formulation est la bienvenue.
116
Mercredi 22 septembre
Voici le lien vers un très bon documentaire sur l’un des plus grands, bagarreur qui plus est. Entre autres choses, on y apprend que Le Caravage n’hésitait pas à recommencer à zéro une toile mal engagée. Il peignait directement, découpait les contours du revers de son pinceau comme un sculpteur taille dans la masse, puis retirait sans cesse. Son geste est une épure. Il y a dans ce film largement de quoi donner des forces à ceux qui viendraient à passer par ici et voudraient se lancer à leur tour dans un travail de longue haleine.

115 – chant (modifié)
Vendredi 17 septembre
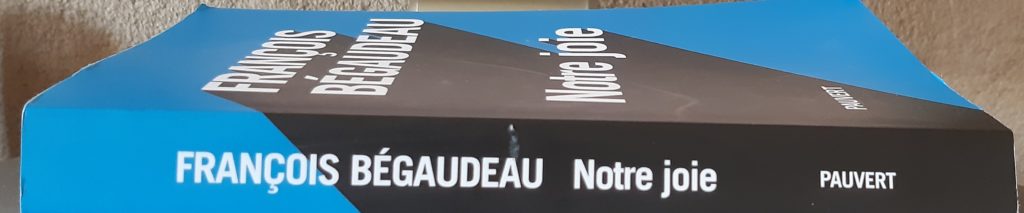
Comme à chaque fois j’ai très vite lu le dernier texte de François Bégaudeau – Notre joie, cette fois-ci un essai. La raison pour laquelle je vais si vite est le rythme. Je me fais toujours prendre, il y a quelque chose dans l’enchaînement des phrases qui pousse à avancer à vive allure. Or, je le sais maintenant puisque une habitude s’est installée : à tenir ainsi la cadence pendant plusieurs dizaines de pages je constate un effet progressif, étrange, pour tout dire un peu hallucinatoire. Par ma lecture anormalement rapide je me sais partiellement responsable de cet effet. Mais ce n’est pas pour rien. J’ai bien raison de lire ainsi. Je maintiens que les textes de cet auteur s’y prêtent. Plus encore : ils demandent, voire exigent un déchiffrage sous tension. Or le fait de loin le plus étonnant se trouve ici : dans tout ce qui est écrit, rien ne dévie jamais. Ni la grammaire, ni le propos. Je ne vois, dans ce texte encore, nulle volonté de perdre le lecteur, et d’exprimer une quelconque folie encore moins.
Au contraire la succession des idées est on ne peut plus rigoureuse. Les phrases sont plutôt courtes – sujet, verbe, compléments ; surtout pas de fioritures ; quelques expressions figées modifiées pour l’occasion et ainsi appuyer un sens nouveau. Et pourtant si l’on n’y prend garde le flux tendu vient à provoquer comme une sortie de route. Le réel décrit gagne en intensité jusqu’à produire un trouble. Dans tout cela il faut continuer à suivre, d’autant plus que la progression s’avère serrée (comme je parlais il y a quelques jours de scénario serré : aucune place pour le vide, le temps mort ni même l’hésitation). Si l’on ne veut rien perdre du raisonnement, il n’y a alors pas d’autre choix que de sérieusement s’accrocher.
Au fil de la lecture il m’arrive sans doute de manquer des éléments. Face à une telle pression parfois je failllis. D’autant que je m’obstine à lire vite. Entre l’écrit et ma compréhension il y a des pertes à déplorer. À commencer par les transitions. C’est tellement vrai que de tout le livre je n’en ai pas vraiment repéré. C’est que la radicalité de F. Bégaudeau s’est sûrement accentuée. Et si dans Jouer juste je n’avais aperçu qu’un seul point – non pas parce que n’en voyant pas j’en cherchais un à tout prix mais au contraire parce que, tombant soudain sur celui-ci aux deux tiers du roman, je réalisais a posteriori que je n’en avais noté aucun autre auparavant -, impossible cette fois de dire si cet essai contient une seule transition entre deux idées censément différentes.
Or, forme et fond ne faisant qu’un (autrement dit, la différence entre forme et fond étant une vue de l’esprit qui, soit dit en passant, ne diffère pas du corps), la lecture du texte amène à s’interroger : deux idées qui glissent ainsi de l’une à l’autre dans le sens de la lecture restent-elles distinctes ? En l’occurrence il semblerait que non. Plus tant que ça. Ici les idées se suivent. Les idées se ressemblent. Elles se contaminent. L’une pousse l’autre. Si bien que l’on se retrouve à la dernière page de Notre joie sans avoir totalement saisi par quels moyens on y est arrivé. Ce qui reste est en revanche le sentiment d’un raisonnement aussi sûr de lui qu’implacable. De ce point de vue, le texte menace en permanence de nous déborder. Embarquée dans le rythme, à moi seule donc de refuser de me laisser porter. Au lecteur de rester vigilant. D’ouvrir l’œil et continuer à découper dans le bloc des 319 pages pour séparer les idées, reconnaître leur agencement. François Bégaudeau ne nous aidera pas. Il ne nous mâchera pas le travail. Pas le genre. Sauf que.
Avec un tel rythme, disais-je, la pensée finira de toute façon par décoller pour de bon. On pourrait dire : comme détourée. Dans Deux Singes ou ma vie politique, l’auteur fustigeait sa tendance virtuose et juvénile à aimer le raisonnement pour lui-même et pratiquer l’exercice rhétorique pour la beauté du geste. Il dit les vouloir à présent tous deux solidement ancrés au réel. Pas de problème de ce côté-là, c’est le cas. Mais désormais, c’est bien à partir de la description de l’existant – une soirée de discussion à Lyon, telle conséquence très concrète du libéralisme, des événements historiques, des comportements déterminés socialement ou bien par la douleur – que quelque chose advient. Quelque chose que je reconnais pour l’avoir si souvent lu, voulu, recherché et un peu analysé.
Avant de travailler sur la répétition, objet d’étude littéraire qui s’est transformé au fil des ans en un plus large intérêt pour les procédés de dédoublement en art, j’avais travaillé sur l’incantation. À l’époque, ne comprenant pas ce que j’aimais tant chez cet auteur qui parlait à longueur de pages d’un dieu auquel je ne croyais pas, je m’étais spécifiquement penchée sur le cas Paul Claudel. Plus tard, dans mon cheminement parallèle de lectrice et d’étudiante, la répétition m’était tombée dans les mains comme une forme particulière de l’incantation, l’un de ses éléments constitutifs les plus efficaces. Je n’ai aucun doute là-dessus : François Begaudeau tisse son texte en une longue incantation. Une prière indifférente au futur qui cette fois, se passe de répétition – pas le temps pour cela. On la récitera d’une voix neutre. On s’approche : ce texte est un chant sans lyrisme ni refrain.
Par sa puissance mimétique le chant fore dans la vie. De phrase en phrase le chant va. Je ne dis pas que l’auteur parvient toujours à cet effet, et crois qu’il pourrait aller encore davantage. Mais c’est là, indéniablement, que lui et son chant se dirigent. Certes, employer un tel lexique est tentant quand on connaît le goût de F. Bégaudeau pour les textes chrétiens. Ici rien à voir en fait. J’applique pour ce livre la même méthode que pour toute autre oeuvre, et qui consiste à partir des sensations et des effets physiques – auxquels je suis plutôt prompte, on l’aura compris – que ce dernier suscite. Il aura fallu passer par le détour de l’essai et des arguments qu’il charrie à toute allure, dans une cadence qui fait la marque de l’auteur pour y voir plus clair.
« Individu est le nom mal foutu d’une zone d’échange entre intérieur et extérieur, à travers la membrane absolument poreuse qui m’entoure. Une zone où ça pense, ça mange, ça gratte, ça tombe amoureux, ça parle. Ce n’est pas moi qui parle ; c’est des mots qui me viennent, des sons qui me prennent que je ne comprends pas moi-même. La langue parle en moi. La langue dont je n’ai inventé aucun mot. Je ne fais qu’emprunter. J’attrape des vocables puis les rends. J’absorbe et je recrache. J’ingurgite et régurgite. Dans l’usine de mon corps, tout mouvement du dehors vers mon dedans a son symétrique : j’ingère autant que je chie, je boie autant que je pisse. Je ne suis pas poreux, poreux n’est pas un attribut, poreux est moi. Je ne suis que pores. La vie je la sens par tous les pores sans y rien pouvoir. Je ne maîtrise aucun des flux qui ont lieu en moi. Je suis un lieu de passage. Je suis un hall de gare. »
Note du 17 décembre 2021
Depuis la rédaction de ce billet une autre image, plus juste que le chant, m’est venue. Je la signale car maintenant que j’ai trouvé, mon imprécision me dérange. L’image est plus étonnante (moins attendue) mais cette fois c’est la bonne. C’est un geste : le mouvement du pouce que fait celui qui utilise un chapelet. Celui-là même qu’on voit faire parfois dans le métro par certains hommes absorbés dans leur tâche. En lisant c’est bien ce geste vif et répétitif – et faut-il le préciser, assez fascinant – que je voyais. Un geste qui recueille et expédie à la fois. S’appuie et élance.
Pas tant une prière donc que le geste qui l’initie (la précision me semble importante). Nulle mélodie non plus (ça je l’avais déjà identifié), mais une impulsion. On saisit, on balance puis enchaîne, car c’est comme ça que quelque chose peut advenir : de la pensée, de la vie.
114 – valeurs (marchandes)
Jeudi 16 septembre
« Il n’y a pas de sans-frontiérisme, il y a que le marchand veut écouler sa camelote. Pour ça il a besoin d’un marché. Si la demande intérieure baisse, il lorgne sur le marché d’à côté et se démène pour qu’il s’ouvre. Remettons l’envers à l’endroit : c’est parce qu’il a besoin que ses marchandises passent les frontières qu’il prône leur ouverture, rhabillant au passage sa voracité planétaire en ode au nomadisme, à l’ouverture, au progrès, à la 5G. » (François Bégaudeau, Notre joie)
« Malgré ses nombreux succès dans la télématique, et son statut d’entrepreneur prodige, Pascal avait peur de lanquer la révolution Internet. Il avait djà vongt-six ans. En économie comme en aastronomie, les conjonctions propices étaient rares, et les fenêtres de tir se refermaient très vite.
C’est donc avec une certaine précipitation que Pascal lança le 3615 INTERNET, la première interconnexion commerciale entre le Minitel et Internet. Ce service, qui permettait d’échanger des courriers électroniques dans le monde entier, resta cependant le plus confidentiel des produits d’Ithaque.
Alors que les activités commerciales sur Internet, rassemblées sous le nom de domaine « .com » étaient encore à ce stade embryonnaire, […] il n’existait en réalité qu’une manière de rendre Internet profitable à Ithaque : c’était, en se tenant légèrement en retrait de la bataille principale, de vendre à des particuliers et à des entreprises des accès au réseau. Sur ce marché émergent, la concurrence était encore infime. » (Aurélien Bellanger, La théorie de l’information)
Il y a chez les deux auteurs (F. Bégaudeau et A. Bellanger) cette clarté commune, cette sèche connaissance des situations économiques et des motivations patronales. Elle est d’autant plus aimable qu’elle reste rare, car trop souvent polluée justement par l’éternel discours sur les valeurs (en réalité toujours changeantes, a posteriori et opportunistes) asséné par les libéraux. Heureuse surprise des lectures simultanées.
113 – détourage
Mardi 14 septembre
Dans Tetro de Francis Ford Coppola, on a l’impression que tout ce qui est au premier plan a été détouré. Le contour se dessine et le fond se détache, comme si deux scènes différentes, à l’avant et à l’arrière, se déroulaient telles des vies propres et difficilement ajustables. Je me souviens d’avoir lu, alors que je sortais de l’adolescence la description exacte d’un tel effet chez Gérard de Nerval. C’était dans un texte de Roland Barthes. Dans ses oeuvres les maisons, les collines et tout ce qui traçait une perspective au milieu du paysage semblaient selon l’essayiste séparé du reste. Il parlait alors de « vision schizophrène ». En plus du détourage, dans un film les jeux de contrastes, les clairs obscurs, les contre-plongées créent ce léger décollage du réel. Parfois il en faut peu : un tout petit effort d’imagination. Je lisais l’essai de Barthes dans le train, je n’avais qu’à lever les yeux vers la fenêtre et regarder l’horizon.

