Samedi 7 août
Accueillir les cadeaux (de Noël) et bien rire.

Sarga
Samedi 7 août
Accueillir les cadeaux (de Noël) et bien rire.

Vendredi 6 août
Pour la jubilation que procure sa lecture, ce passage évoquant le souffle d’insubordination qui traversa l’Amérique au début des années 1970 dans les usines automobiles :
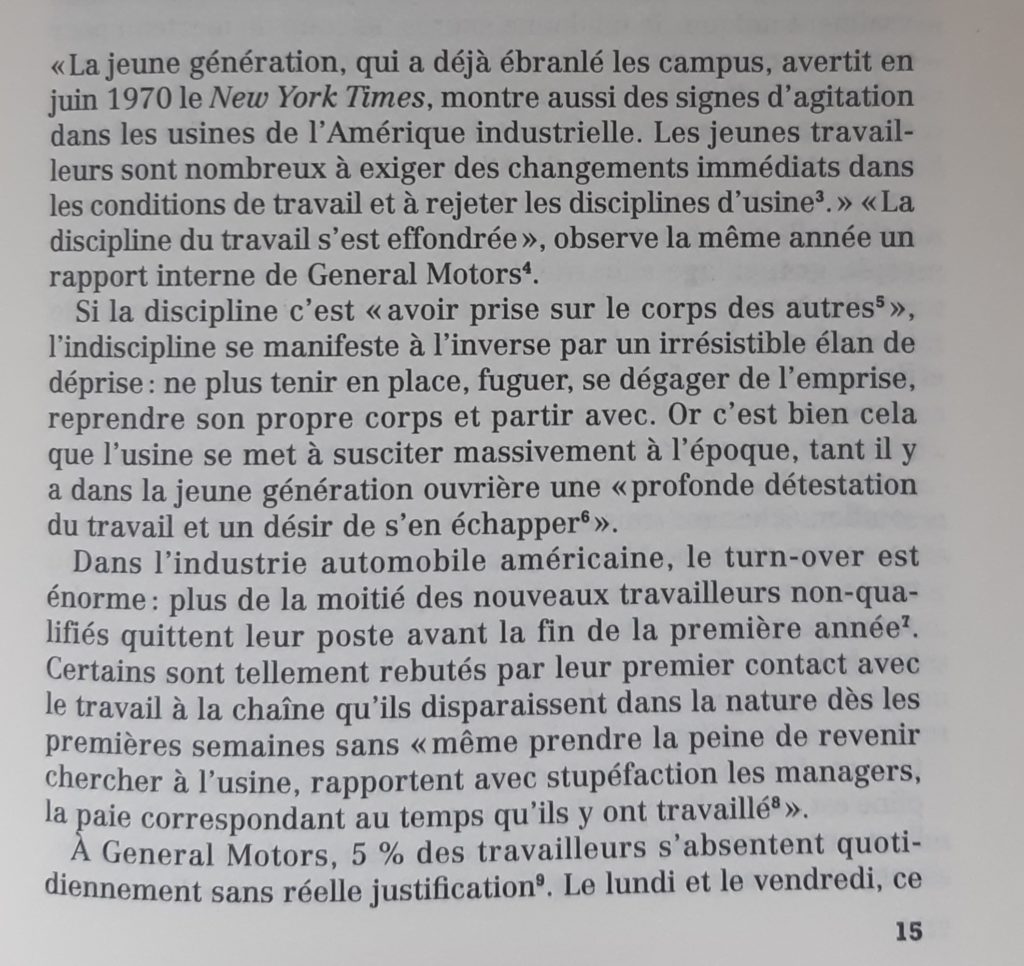
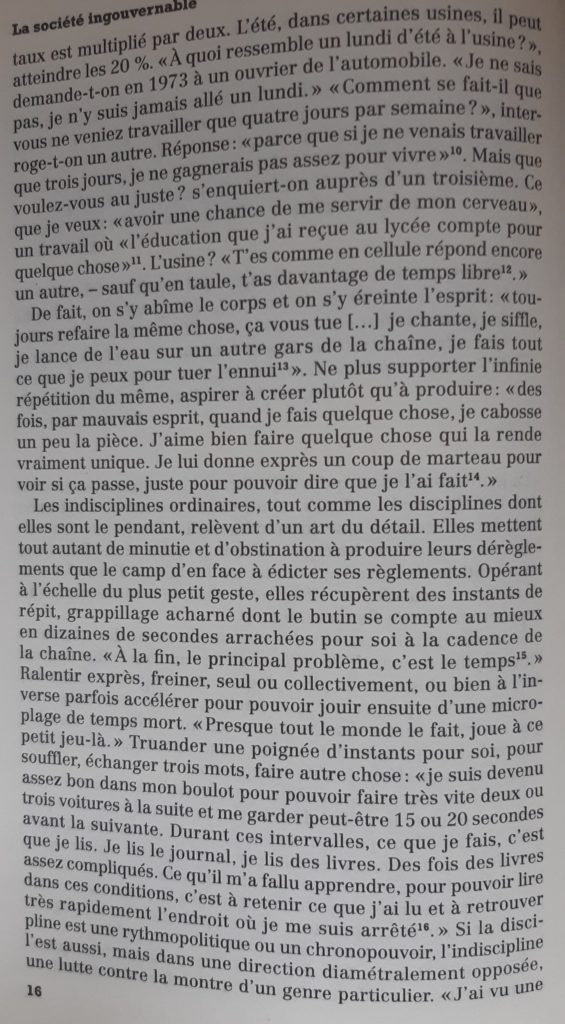
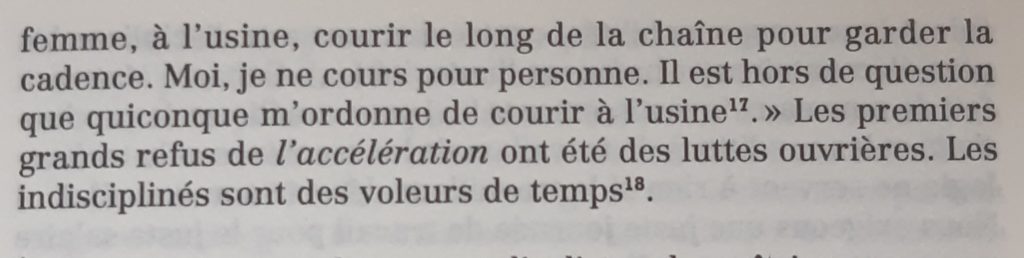
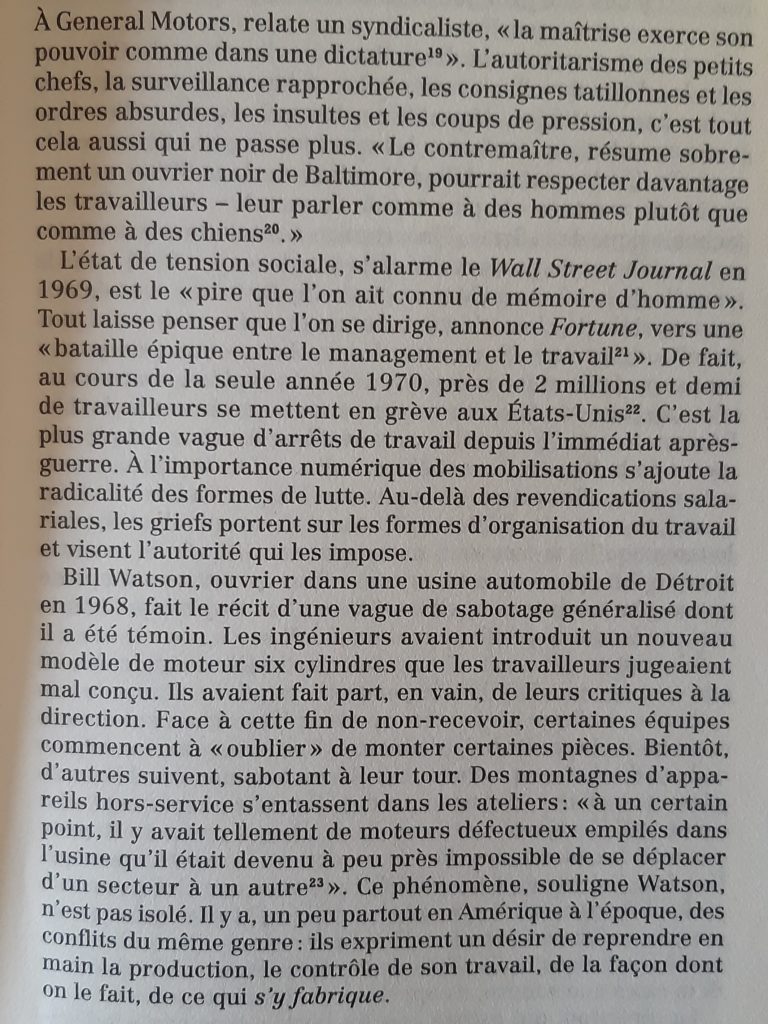
Ces récits qui ouvrent La société ingouvernable – Une généalogie du libéralisme autoritaire contrastent avec l’état de soumission et de colère rentrée auquel semble réduit le monde ouvrier quarante ans plus tard, et dont on retrouve la description précise, à quelques rares moments de rigolade près, dans À la ligne de Joseph Pontus.
Cet essai de Grégoire Chamayou se propose d’expliquer dans le détail comment on est passé de l’un à l’autre.
On peut déjà résumer en quelques mots la stratégie d’étouffement des élans de toute une génération :
« La théorie dominante de la crise – appelons-la « théorie du rapport de force » – incriminait une situation socio-économique trop propice aux travailleurs et à leurs luttes. En deça des considérations psychologiques, elle l’attribuait à trois facteurs principaux : 1° l’engagement keynésien au maintien du plein-emploi. 2° les dispositifs de protection sociale de l’état-providence, 3° la puissance des syndicats. Si l’on voulait renverser la tendance, plus aucun de ces piliers ne devait rester debout. »
Jeudi 5 août
À une amie artiste, je lis cette citation du roman d’Oxford : « Je ne peux me permettre de disposer de tout mon temps et de n’avoir à qui penser, parce que sinon, si je ne pense à personne mais seulement aux choses, si je ne vis pas mon séjour et ma vie dans le conflit avec quelqu’un ou dans sa prévision ou anticipation, je finirai par ne penser à rien, désintéressé de tout ce qui m’entoure mais aussi de tout ce qui pourrait venir de moi. Peut-être Cromer-Blake a-t-il raison, au moins en partie : peut-être le plus pernicieux, et de plus, impossible, est-il de ne pas penser aux femmes ou dans son cas aux hommes, à une femme, comme s’il y avait une partie de notre cerveau réservée à cette sorte de pensées refusées des autres parties et peut-être même méprisées, mais sans lesquelles elles non plus ne pourraient fonctionner de façon féconde, correcte. Comme si ne penser à personne (même au cas où personne serait multiple) empêchait de penser à quoi que ce fût. »
Je lui parle de ce passage parce que depuis que j’ai fait le plan de mon texte j’ai le sentiment de n’avoir plus personne à qui l’adresser (ce n’était pas le cas pendant son élaboration). Tout destinataire évanoui, je n’arrive pas à passer à l’écriture. En revanche je ne suis pas en manque de « conflit » ou de son « anticipation », comme c’est le cas du narrateur. Mon amie confirme : quand elle travaille elle s’adresse à quelqu’un. Mais chez elle ce quelqu’un est changeant (la personne est toujours « multiple »). Ce n’est pas plutôt une seule personne comme pour moi, mais tout un tas de gens qui ont traversé sa vie, morts ou vivants. Elle se met à me faire la liste : « là, quand j’ai fait ça, je pensais à telle personne, là à toi, là à untel et là à tel autre ». Des gens que je connais pour la plupart, d’autres dont elle m’a parlé mille fois. Plein de gens, de toutes périodes. Des proches, d’autres artistes dont le travail l’a marquée. C’est très impressionnant et surtout très beau. Et elle a raison. Elle a raison de s’adresser à autant de monde.
C’est cette générosité qui fera que son oeuvre durera. De cela je suis absolument persuadée. Non pas que son adresse multiple et égalitaire (par opposition à ma focalisation sur une seule entité dominant d’autres présences) la rendrait universelle (je ne suis pas sûre que l’expression signifie quelque chose ; du moins elle noie la compréhension), mais qu’une oeuvre fondée sur autant d’amour (c’est le terme qu’elle utiliserait) est vouée à s’étendre : à parler de nouveau à d’autres gens, des gens précis, plein d’autres, y compris dans le futur. C’est peut-être une vue de l’esprit. Il n’y a sans doute pas de justice divine/morale capable d’élire certaines oeuvres plutôt que d’autres sur la base du degré d’altruisme motivant leur conception. Il n’y en a pas ailleurs, alors pourquoi y en aurait-il en art ? Peu importe, elle a raison de se laisser une telle ouverture créatrice. En l’entendant je ne pouvais m’empêcher de penser : « elle tient quelque chose, là ». En outre, c’est passionnant de voir comme des structures affectives qu’on pourrait dire pré-conscientes déterminent jusqu’à son rapport au travail.
Je me souviens d’avoir lu qu’une auteure contemporaine et assez prolifique disait écrire avant tout pour se venger. Et quoi, elle veut donc se venger tout le temps ? Je ne sais pas si un travail stimulé par le désir de vengeance peut produire une oeuvre de qualité mais ce n’est certainement pas à envier. Le travail est une part de vie, et je ne voudrais pas laisser macérer cette part (la moindre part, d’ailleurs) dans le ressentiment. Mais de toute manière, en cherchant je ne vois pas de grande oeuvre de cette sorte. Même par exemple la peinture du Caravage, dont on connaît le caractère épouvantable. Certes il a dû mettre à mort plus d’un de ses ennemis dans ses tableaux ; mais à l’évidence il aimait aussi les pauvres gens qu’il représentait. Les prostituées, les malades et les gueux. Pour ne serait-ce que penser à les peindre alors que personne avant lui ne l’avait fait, il fallait les aimer. Ne fonder son travail que sur de sombres affects, cela ne me paraît pas viable. En attendant tout reste à faire : repartir en quête d’adresseS.
Mercredi 4 août
Les choix qu’on nous laisse au bout d’une chaîne de décisions dont on ne maîtrise rien n’en portent que le nom.
« – Have you thought about what animal you’d like to be if you end up alone ?
– Yes, a lobster.
– Why a lobster ?
– Because lobsters live for over 100 years. And they’re blue bloodered, like aristocrats. And stay fertile all the life. I also like the see very much. I waterski and swim quite well since I was a teenager.
– I must congratulate you. The first thing most people think of is a dog. That’s why the world is full of dogs. »
« – Avez-vous réfléchi à quel animal vous voudriez être si vous finissez seul ?
– Oui, un homard.
– Pourquoi un homard ?
– Parce que les homards vivent plus de 100 ans. Et ils ont le sang bleu, comme les aristocrates. Et restent fertiles toute leur vie. J’aime aussi beaucoup la mer. Je fais du ski nautique et nage depuis mon adolescence.
– Je dois vous féliciter. La première chose à laquelle pense la plupart des gens, c’est à un chien. C’est pourquoi le monde est rempli de chiens. »
Lundi 2 août
« Il faut réfléchir à ceci : un médecin aujourd’hui doit veiller sur les condamnés à mort, et jusqu’au dernier moment – se juxtaposant ainsi comme préposé au bien-être, comme agent de la non-souffrance, aux fonctionnaires qui, eux, sont chargés de supprimer la vie. Quand le moment de l’exécution approche, on fait aux patients des piqûres de tranquillisants. Utopie de la pudeur judiciaire : ôter l’existence en évitant de laisser sentir le mal, priver de tous les droits sans faire souffrir, imposer des peines affranchies de douleur. Le recours à la psycho-pharmacologie et à divers ‘déconnecteurs’ physiologiques, même s’il doit être provisoire, est dans le droit fil de cette pénalité ‘incorporelle’. […] »
Il est possible que je n’aie pas réalisé quand j’ai lu la première fois Surveiller et punir que la peine capitale existait encore en France à sa publication. À moins que je revive une seconde fois au détour d’une phrase de Foucault, parce que je l’avais oubliée, la même plongée soudaine et inattendue dans une époque que je n’ai pas connue mais pas si ancienne, une époque à portée de main. Dans l’un ou l’autre cas, la prise de conscience est abrupte.
Dimanche 1er août
Sur Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin. Dans le premier tiers du long-métrage, le temps que l’histoire se mette en place, plein de petits détails gênaient l’adhésion totale à ce que je voyais (à commencer par la musique, franchement superflue sauf une fois que s’impose le Requiem de Mozart, mais bon, le Requiem, quoi ; l’héroïne suçant son pouce dès qu’elle s’allonge ; certains angles de vue faussement maladroits et autres prises en caméra à l’épaule). Jusqu’à ce que les personnages viennent nous happer. Shéhérazade d’abord, jouée par une actrice qui crève l’écran, aux intonations fortes et tranchantes, belle, fière comme savent l’être les Arabes au point de donner l’illusion qu’elle est invulnérable.
Puis Zac, émergeant beaucoup plus progressivement. Et celui dont on pensait au départ qu’il n’avait les épaules pour à peu près rien, et certainement pas pour se mesurer aux caïds de la cité phocéenne et protéger des filles soumises aux caprices des autres hommes, celui qui semblait n’agir que sous des impulsions dignes d’un enfant de dix ans s’avère capable de choisir – choisir – la voie qui le sauvera. Or sa puissance lentement acquise est celle de l’aveu de sa sensibilité. Ce pourrait être un miracle, la force du scénario est de le justifier parfaitement.
Scène après scène, le film se débarrasse alors de ses légers effets parasites pour aller à l’essentiel. Et les très grands moments de la dernière partie du film, le procès puis la visite surprise de Shéhérazade, venue lui donner un morceau de pâtisserie trop gros pour passer par le trou du grillage – quelle trouvaille – ont de quoi nous essorer en deux temps. Pendant le procès le ventre se serre, pendant la visite la substance lacrimale se met à couler. Tout cela il va sans dire, arrivant sans prévenir.
Ce qui est probablement le plus remarquable ici, c’est l’usage de la parole. Pendant près de deux heures, il n’y a aucune fausse note. Deux exemples, extraits de la scène du procès, pourront peut-être mieux faire saisir cet aspect si particulier du film :
1- les difficultés qu’a Riyad, le violeur de Shéhérazade, à qualifier l’acte sexuel devant la juge. Il s’y reprend à plusieurs reprises et alterne entre des termes triviaux et d’autres comiquement neutres tout en s’excusant de sa maladresse. Tout se passe comme s’il s’emmêlait entre les qualificatifs attendus par l’institution judiciaire, ceux qu’il doit éviter parce que trop vulgaires, et celui qui pourrait le faire condamner. Dans ces balbutiements, on entend toute la confusion probablement sincère du personnage : est-ce que si je dis « niquer », je dis que je l’ai violée ? et d’ailleurs, est-ce que niquer une pute c’est violer ? C’est finalement Zac qui posera les mots justes sur les motivations du crime, et permettra de distinguer ce qui s’est réellement passé : Riyad s’est vengé en faisant ce qu’il a fait à Shéhérazade, « parce que je tiens à elle. Parce que je l’aime. »
2- Après que la juge ait demandé à Shéhérazade ce qu’elle a dit quand Riyad et ses collègues lui ont proposé de monter dans la voiture, celle-ci répond simplement : Non. (= « J’ai dit non »). Non seulement ce non redit sur un ton très ferme ressemble totalement à Shéhérazade (et laissant ainsi entendre d’une façon assez bouleversante ce qu’elle est, fait surgir la scène entre elle et les jeunes hommes), mais en plus, il est à l’image du reste du film. Nulle part il n’y a de place pour la tergiversation. Être ambigu, hésiter, pour tous ces jeunes livrés à eux-mêmes c’est donner la possibilité de se faire manger. Chaque parole pour être entendue se doit d’être brute et claire. Chaque parole est entendue.

Samedi 31 juillet

Le hasard relatif de Twitter m’a amenée à écouter une série de morceaux de musique en réponse au tweet d’un abonné. Ils étaient de styles très différents mais se sont avérés tous assez, voire très bons. Ça fait partie des surprises dont sont capables les réseaux sociaux quand pour une raison ou une autre, une communauté éphémère s’y forme et produit à la fois du jeu et de la qualité. Mais parmi la masse des chansons une se distinguait. Alors en tirant un peu une pelote est venue. La pelote s’appelle Ratatat. J’ai donc découvert un groupe, qui existe probablement depuis 25 ans et passe sans doute sur Faubourg Simone à rythme régulier, bref un summum de branchitude, mais peu importe, c’est magnifique et ça me fera au moins les dix prochaines années. Quel bonheur d’avoir trouvé cette manne.
Compliqué, de dire ce qu’on aime dans telle ou telle musique. Là ce serait disons le côté profond, ancré, et le côté aérien. L’absence de paroles. Ainsi que la capacité à donner progressivement et sans en avoir l’air, dans l’espace de la répétition, de l’intensité aux morceaux. Il y a une grande finesse dans la composition.
Trois propositions, mais à vrai dire tous les morceaux entendus pour le moment sont plus beaux les uns que les autres. Plus exactement, c’est comme une variation infinie sur un même son. Si on n’aime pas l’un, alors il me semble que c’est qu’on n’en aime aucun : 1) Cream on chrome, celui par lequel je suis rentrée – 2) Lex et 3) Gettysburg ou Wildcat. Et puis celui-là également et le plus remuant Nightclub Amnesia dans l’album Magnifique. Mais aussi globalement tout l’album Classics.
Vendredi 30 juillet
Ça y est, je l’ai ma scène, en tout cas je la vois. Et par la même occasion tiens enfin la preuve que matière et pensée sont une seule même chose : toutes deux obéissent pareillement à la loi de Lavoisier (dont j’apprends qu’il est mort guillotiné en 1794) ! Il est toujours un peu magique, ce moment où l’on découvre que tout était là depuis plusieurs jours, n’attendant plus qu’à se combiner à l’intérieur de son cerveau (mrci Marías, Nelle et Nagg, merci Semmelweis, merci James Corden et Tom Cruise).
Ce ne sera pas une description par le vide mais par découpes.

Vendredi 30 juillet
Relu la géniale scène du suicide qui ouvre Un coeur si blanc : j’en avais besoin pour une scène (pas de suicide) de mon texte en début de chantier. Deux éléments importants :
1 – l’acte et le corps de la jeune femme sont à peine évoqués. Le narrateur raconte en réalité tout ce qui gravite autour de la mort(e) : la plaie au coeur n’est pas décrite mais seulement l’autre sein, intact ; puis c’est au tour des gens qui s’affairent ; suivent les petites mesquineries des personnages présents, jamais évoquées comme telles mais comme de simples faits en trop et qui viennent en quelque sorte se plaquer sur le corps gisant : un invité se recoiffe devant le miroir, le jeune commis boit le verre de vin tout juste rempli avant de s’éclipser. Surtout, c’est le désarroi de la bonne qui est excellent à lire. On a alors un pied dans la gestion routinière de la vie de cette famille et un autre dans l’irruption dramatique, exactement comme elle tient un pied dans la salle de bain et l’autre encore dans le couloir.
2 – en complément : tous les gestes inutiles et un peu incohérents qui sont effectués par les membres de la famille au moment de la découverte du corps. La scène rend parfaitement le sentiment d’une improvisation devant l’inimaginable. Le père, la soeur et le mari apparaissent à la fois comme des machines fonctionnant de manière automatique et comme des animaux acculés et qui ne savent pas dans quelle direction aller pour échapper à la terrible réalité qui est train de s’imposer. Là encore, le croisement normal, habituel/anormal, exceptionnel est particulièrement intéressant.
Pour ma scène ce type de description par le vide me paraît assez idéal.
En revanche il n’est pas censé y avoir d’improvisation de la part des personnages (puisqu’il s’agit d’un acte médical). Réfléchir tout de même à des micro-éléments qui, malgré tout le caractère protocolaire de l’opération, pourraient brouiller le cours ordinaire des choses.
Mardi 27 juillet
Ce blog avait pour principal but d’évoquer des oeuvres et des procédés de création qui me semblaient intéressants. Pour faire exclusivement de la critique positive, si l’on veut. Il y a tout de même un domaine qui mérite vraiment qu’on s’y penche : c’est celui de l’esbroufe. L’esbroufe concerne le film ou le roman qui marche et est célébré parce qu’il a les signes, non pas de la qualité, mais du succès. Il est intéressant de se demander si, de même qu’il y a une infinité de possibilités de créer un objet artistique fort et bon, il existe une infinité de manières de faire de l’esbroufe. Peut-être pas, le nombre des codes faciles à une époque précise s’avérant peut-être limité. Il est possible également que cette question soit en lien avec le vocabulaire étonnamment restreint de la critique que je constatais il y a quelques billets de ça, et qui nous fait formuler en des termes similaires l’éloge à un chef d’oeuvre et à une véritable daube. Comme si l’on pouvait, finalement, distribuer les bons points au hasard. Il faut voir, donc. Et il faut voir même absolument pour une raison simple, à savoir que la tentation de l’esbroufe est immense, permanente et toujours séduisante lorsqu’on travaille à une oeuvre. Il faut tout le temps lutter pour ne pas y céder. C’est pour cela que la création véritable implique un constant mouvement de refus. Malgré l’élan indispensable à tout geste créateur et la nécessité de se sentir concerné par ce qu’on fait, l’art quand il est grand se veut contre-pulsionnel.
Je ne vais pas revenir très longtemps sur Sonoma, de Marcos Morau. Non que j’aurais mieux à faire, mais parce que c’est très difficile d’expliquer en quoi faire clamer à de belles femmes, ici typées (espagnoles), des affirmations insensées mais vaguement propĥétiques sous des chants à la Goran Bregović, même dans le cadre sublime du Palais des Papes d’Avignon, ne peut en aucun cas constituer une oeuvre exceptionnelle. C’est d’autant plus dommage que certaines parties du spectacle sont superbes, celles notamment où les femmes gigotent comme des automates déréglés, le visage recouvert. Ça pourrait être douteux mais le fait est que là, il se passe quelque chose.
Malheureusement, comme nombre de chorégraphes, Marcos Morau est malade de vouloir absolument injecter du sens à son oeuvre. On trouve trop souvent chez eux ce désir de dire quelque chose. Dans ce cas, et très logiquement, beaucoup d’artistes font appel à ce qui produit le plus immédiatement et le plus facilement des idées, du concept, à savoir la parole. La chorégraphie court ainsi après le théâtre qui a acquis ses lettres de noblesse bien plus tôt qu’elle, comme si elle voulait régler un vieux complexe d’infériorité. Mais c’est une erreur, une énorme erreur. Car ce qui est beau dans la danse, c’est précisément son absence totale de sens. Cet art ne peut devenir puissant que lorqu’il s’astreint à exposer des corps, quand il se concentre sur ce seul geste pour en exploiter les formes, individuelles et collectives, et les possibilités infinies. La chorégraphie doit rester une pure jouissance du mouvement et de la transformation. Ce faisant elle doit faire du spectateur une bête : un être sensible recevant des stimulis visuels et auditifs. Et c’est tout. Surtout, qu’aucune prétention ne vienne s’ajouter à cette ambition déjà immense ou c’est le ratage assuré.
Dans ce spectacle, au milieu des paroles pompeuses sans pensée consistante, sous une musique aux accents religieux vidée de toute mystique, ne reste qu’une sorte de boursoufflure. C’est un premier point, mais il me semble que ça ne suffit pas ; que quelque chose m’échappe encore. Car comment prouver de façon imparable que le cliché est un cliché (ce spectacle n’en manque pas) ? Et que le mauvais goût, ou du moins un peu limite ne saurait basculer du bon côté même avec la meilleure volonté du public ? Ce sont de vraies questions : plus encore que pour ce qui est réussi, il me semble que toute démonstration d’un échec esthétique renvoie irrémédiablement à la subjectivité du récepteur. Sauf à expliquer que ces choix esthétiques posent problème sur un plan politique. Mais ce n’est pas le cas ici.