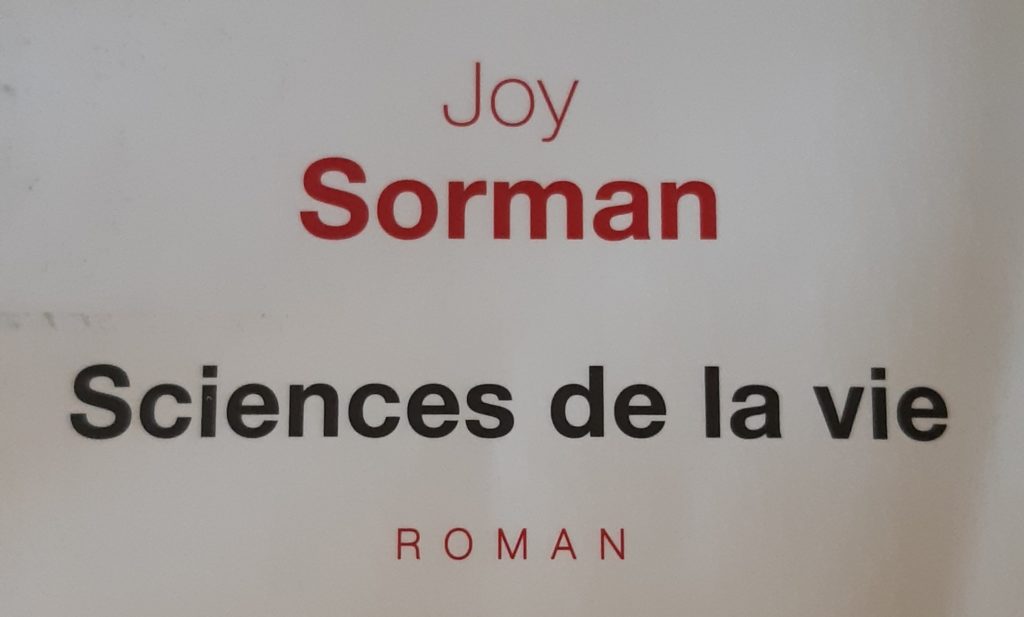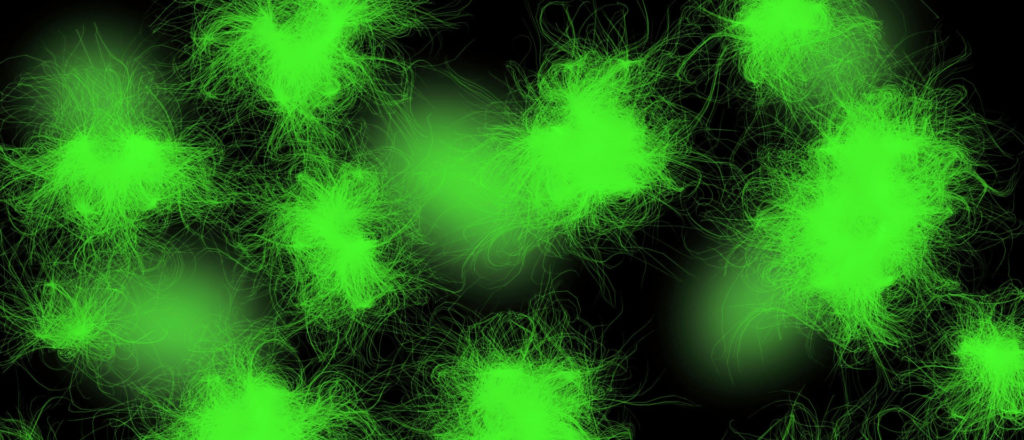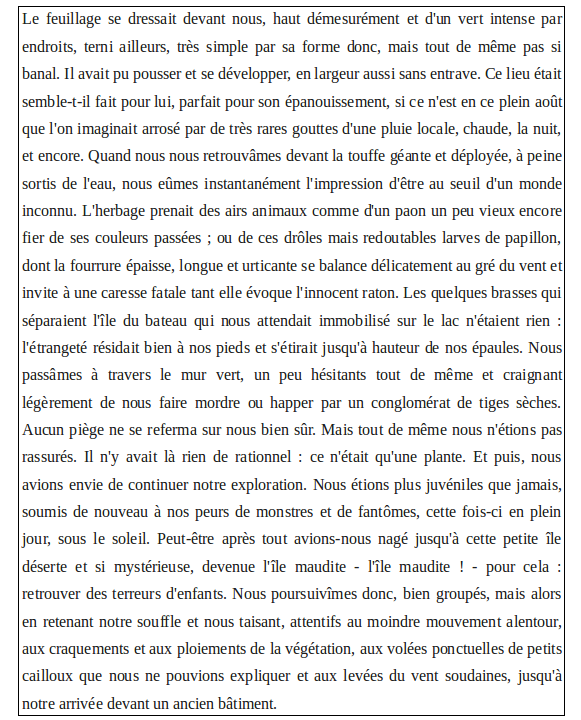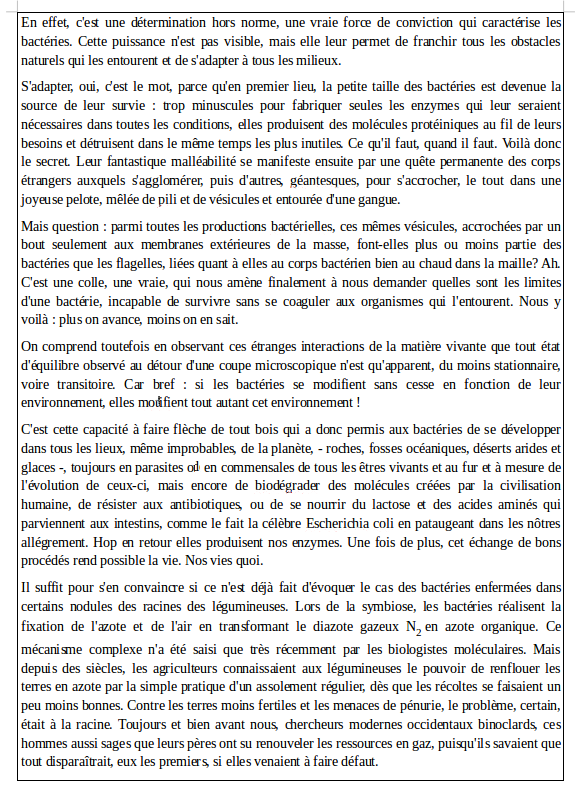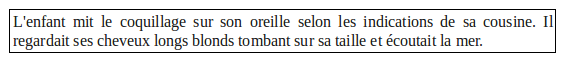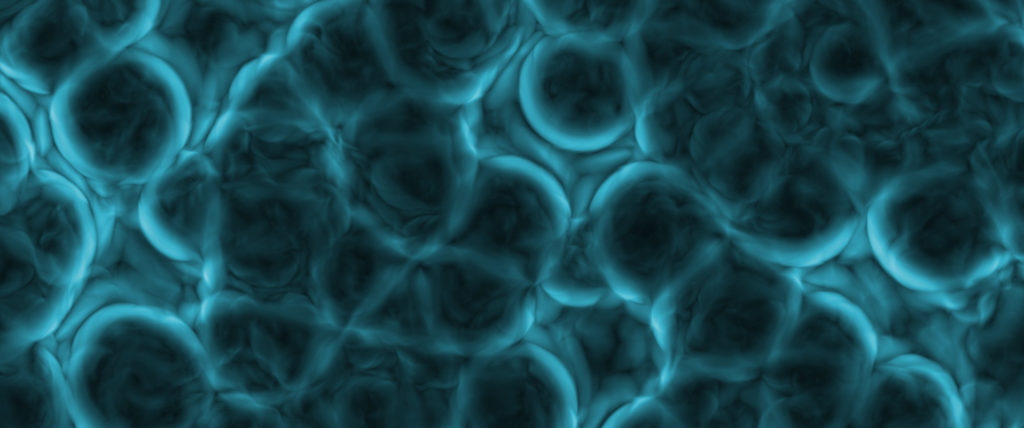Lundi 19 avril
Je termine à l’instant le roman de Tanguy Viel. Ce n’est peut-être pas une très bonne idée de me mettre à écrire tout de suite mais j’ai des horaires à tenir. Je suis encore dans le rythme du monologue du personnage principal Martial Kermeur, encore imprégnée de son histoire, de la longue tirade qu’il tient devant le juge et de la cascade d’images qu’il convoque pour mieux s’en faire comprendre, les laissant s’accumuler, ces images, tout au long de son récit, s’empiler les unes sur les autres comme dans un jeu de Tetris, avec certes, pense-t-on au début, une certaine maîtrise, si bien qu’en tombant en bas de l’écran elles se rangent proprement et font disparaître comme par magie les amas d’incertitude, puis de façon de plus en plus confuse. Tout finit par s’emballer. Et dès lors, quand Martial Kermeur parle de ce qui l’a amené à commettre un crime, c’est comme s’il regardait impuissant les couleurs et les formes envahir son écran, parvenant encore de temps en temps à emboîter deux ou trois morceaux et ralentir quelques instants l’arrivée de la catastrophe ; puis plus rien, quelque chose en lui lâche une bonne fois, quelque chose cesse de lutter et on jurerait alors qu’en racontant son histoire il veut en précipiter la fin, accélérer l’inévitable débordement du malheur.
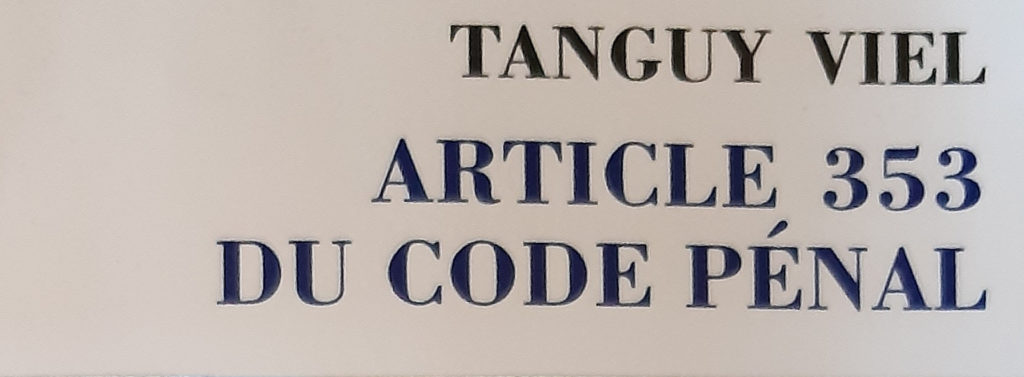
J’ai adoré ce roman. Tout d’abord à cause de cette accumulation de métaphores et de comparaisons. Bien sûr elles sortent de la bouche du personnage, mais je ne peux m’empêcher de penser qu’en les multipliant ainsi au-delà de l’imaginable, l’auteur a voulu faire une expérience littéraire, voir ce que ça fait de laisser proliférer ainsi les images, au point d’en écrire quatre, cinq, six par page – certaines avec une fulgurance rare, certaines plus maladroites, presque empâtées, mais cela aussi c’est d’évidence volontaire. Je n’avais jamais vu ça.
Et en l’occurrence, ça marche : oui c’est possible de plonger dans cette démesure-là, ça ne charge pas le sens, bien au contraire. Et si Kermeur semble s’affaisser au fil du texte alors qu’il enchaîne les comparaisons pour signifier ce qui lui échappe, toutes les pièces du puzzle, elles – les événements qui composent cette histoire de vengeance – s’emboîtent parfaitement. Je suis reconnaissante à l’auteur (et je note que c’est la deuxième fois que j’emploie cette expression à son égard) d’avoir osé mettre autant d’images dans un texte si dense. Il a répondu à une question que je me posais depuis longtemps : jusqu’à quel point ?, en me disant que j’en laissais toujours trop. Or, on dirait bien que pour les images comme pour tant d’autres choses, la réponse est : pas de limite.
Ensuite il y a l’ambiance très cinématographique de ce roman. Les effets visuels sont très puissants dans ce texte :
« Et il a fait cette sorte de quart de tour comme quelqu’un qui serait sur le point de s’en aller mais qui sait déjà qu’il ne partira pas avant d’avoir été au bout de son idée, et il s’est arrêté dan son mouvement, il a tourné la tête vers moi, et il a dit : Si un prochain jour ça vous tente, on pourrait aller pêcher ensemble. »
La scène, je la vois. On la voit tous. J’ai reconnu là la fonction démiurgique ou de metteur en scène que Tanguy Viel cède ponctuellement à ses narrateurs. Les personnages sont souvent mus par des représentations communes, pour ainsi dire des clichés. L’auteur semble s’en amuser.
Un autre élément important que développe particulièrement bien le roman est la question du rapport de force entre les personnages. De mon côté, je veux dire dans mes textes, je ne me suis jamais vraiment attelée à ce qui est pourtant un énorme morceau de compréhension de la psychologie humaine. Pas de manière frontale, du moins. Je sais que je devrai le faire, toute la question étant de savoir comment. En littérature, tant qu’on ne met pas en évidence les rapports de pouvoir et de domination qui existent entre, non : qui façonnent les groupes sociaux comme les individus, on ne rentre pas dans le dur des relations humaines. Or, Tanguy Viel le fait ici de manière assez géniale, montrant dans le même temps une compréhension aussi juste que précise de ce qui se joue. À mon sens, et toujours avec ses images qui n’appartiennent qu’à lui, il ouvre une voie :
« Et franchement, j’ai dit au juge, franchement c’est impossible de savoir, quand un type comme ça vous invite à boire une bière, s’il le fait seulement parce qu’il est seul ce soir-là ou bien s’il a une idée derrière la tête ou bien s’il est seulement fier de lui parce que vous êtes comme la dernière personne qu’il aurait pensé amener là, fier de condescendre en somme, parce qu’un type comme ça, j’ai compris depuis, un type comme ça veut toujours le beurre et l’argent du beurre, eh bien, l’argent du beurre c’est que pendant un temps, Lazenec, il s’est senti ami avec moi. Et moi d’une certaine manière, je l’ai accompagné dans son amitié. »
« Et vous n’imaginez pas, j’ai dit au juge, à cette idée de mener sa barque, soudain, dans un cerveau comme le mien, il y a des vagues de trois mètres qui s’érigent comme des murs d’eau sous mon crâne, moi, dans la barque en question, c’est comme si je m’étais retrouvé seul perdu au milieu de l’océan avec à côté de moi un paquebot géant qui file vers l’Amérique. Alors à cause de ce sentiment même, sous mon crâne, ce fut comme une balle magique qui frappait d’un côté l’autre et cassait toutes les vitres. Et en même temps qu’il y avait cette balle rebondissante qui faisait plus de dégâts qu’une pierre dans un lac, je dis bien « en même temps », il y avait quelque chose en moi qui se gonflait d’orgueil ou je ne sais pas, de souveraineté, quelque chose qui disait, oui, c’est vrai, tu sais mener ta barque – et sans savoir que lui, Lazenec, dans mon orgueil, dans ma résistance, dans mon libre-arbitre, bientôt il pourrait s’y vautrer comme dans un canapé en cuir dont il aurait lui-même consolidé les coutures. »