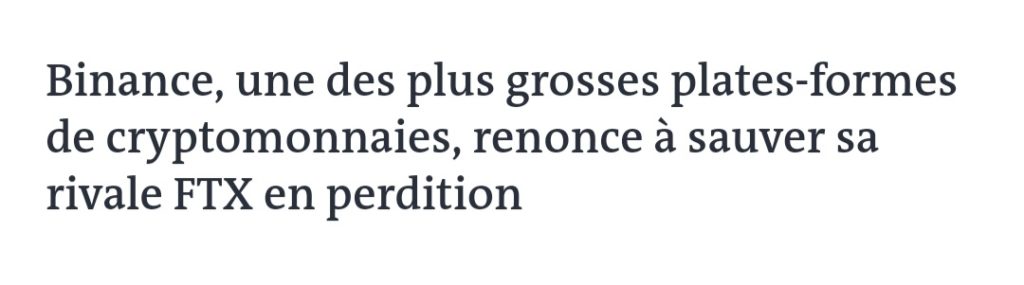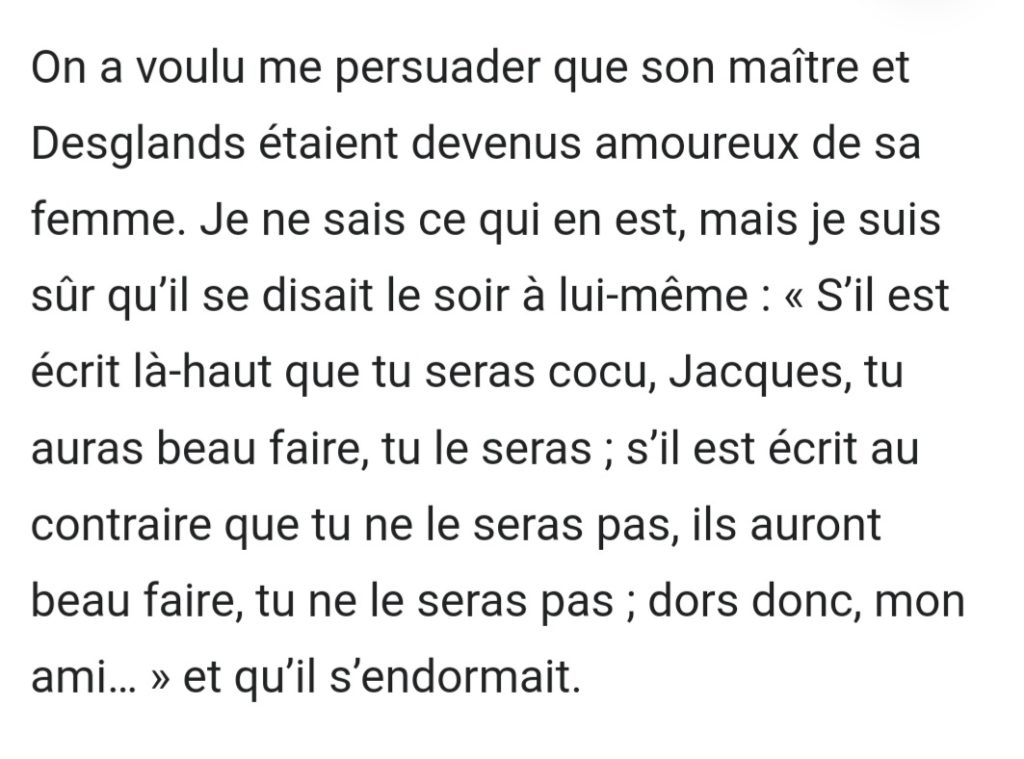Mardi 15 novembre
Le hasard a fait que mon premier Michel Franco fut aussi mon premier achat en ligne d’un film. Je n’en suis pas fière mais la chair est faible hélas et j’ai vu tous les films (qui du moins, parmi ceux disponibles gratuitement, me faisaient envie).
Celui-ci est bon. Ses acteurs, excellents – Tim Roth comme toujours, mais il faut dire qu’il a assez peu à faire ; Charlotte Gainsbourg, parfaite en héritière anglaise (1), tout comme Henry Goodman en avocat aussi discret qu’efficace. Je suis étonnée de la réception mitigée, voire franchement hostile du film par la presse spécialisée. Celle des Cahiers du cinéma et plus encore de Critikart, dont les articles souvent me conviennent. Toutefois, au cours mes recherches je suis tombée sur une pépite écrite par un « amateur ». Il faut la lire. En voici le lien.
Rien à retirer, une ou deux choses à ajouter. Concernant le découpage habile de l’histoire par le réalisateur, je la salue à mon tour, puisqu’il accomplit une grande prouesse, celle de laisser les liens entre tous les personnages dans une étrange suspension.

Celle-ci est en effet la clé de lecture du film : d’emblée un refus de la morale s’opère (la morale se suspend avec les signaux attendus des relations au sein de la famille autant que dans le milieu populaire d’Acapulco où se mêlent délinquance, mafia, farniente, tourisme et sentiment amoureux). Ce retrait de la morale se fait en effet au bénéfice d’une attention portée aux situations dans leur matérialité. Mais cela a déjà été écrit.
Revenons plutôt sur l’image du mélanome. Sa première occurrence a lieu assez tôt dans le film. Une ancienne et précoce hypocondrie transformée au fil du temps en un intérêt total pour le corps humain – oui, il arrive aussi que des passions tristes finissent par s’égayer – m’a fait reconnaître immédiatement la nature de ce furtif indice, et penser en conséquence que le personnage central, Neil, se savait souffrant. D’après les critiques tous n’ont pas perçu ce moment. Mais pour qui a identifié le symptôme de la maladie, toute l’attitude du héros est dès lors éclairée à la lumière (assommante) de ce soleil de plomb, dont l’image revient avec insistance chaque fois que le malheur s’abat un peu plus sur lui.
Cette information scénaristique, une fois saisie et parfois donc très tôt, a deux conséquences. La positive est que chaque exposition de Neil au soleil produit a minima un malaise. Pour les spectateurs les plus réceptifs, dont je suis, la gêne est même physique. Voir scène après scène le héros se faire griller la peau c’était comme me brûler moi-même – le climax étant le moment où, dans la cour de la prison, Neil s’arrache quelques lambeaux pelés. Chaque plan, aussi paisible semble-t-il, est empreint de douleur (la mienne), du moins de sa promesse (la sienne) et pas seulement intérieure (les nôtres) : une douleur à fleur de derme. Une matérialité morbide, non pas glauque mais gorgée de mort, parvient ainsi à contaminer le reste du film, à tel point que l’on pourrait dire que ce dernier n’est rien d’autre que la chronique silencieuse d’un organisme en train de s’autodétruire.
C’est un élément positif non seulement au sens où quelque chose se passe. Bien plus encore : toute expérience sensorielle, à mon sens, est un cadeau du ciel.

L’autre conséquence, moins plaisante, est que la lecture des comportements du personnage est elle aussi influencée par notre savoir. Il ne s’agit pas tant ici d’un Bartleby, un homme qui fait sécession pour mieux révéler l’absurdité du monde et de ce après quoi chacun semble courir (exemplairement : l’argent, le luxe, les gages d’amour familiaux), que d’un individu face à la certitude de sa mort prochaine. Le film ne s’ouvre pas sur un gouffre, il trace une trajectoire, suit une psychologie. C’est alors, disons, un peu moins fort. Plus trivial.
On a un semblable sentiment de (légère) déception quand Alice, la sœur du héros, accepte sans broncher la part d’héritage de son frère. Après avoir fait des pieds et des mains pour retrouver un peu de l’attention fraternelle, s’être plainte d’avoir été trahie et abandonnée par Neil, elle ne dédaigne pas ce don inexpliqué de la moitié de la fortune familiale. S’en tenir là aurait laissé un formidable goût d’hypocrisie et de vénalité. Mais Neil s’empresse d’expliquer dans la scène suivante que sa sœur « mérite » cet argent car des deux, c’est elle qui s’est investie dans l’entreprise familiale.
D’ailleurs, si l’on y réfléchit, on réalise qu’il y a quelque chose d’absurde à donner sa fortune aux trois êtres qu’on aime quand on sait qu’on va bientôt mourir. On apprend dans le film qu’Alice et ses deux enfants, autrement dit le neveu et la nièce du héros sont toute sa famille. Ils sont tout ce qu’il a. Tout laisse donc penser qu’à sa mort, ce sont eux qui auraient hérité de sa fortune. De toute façon. À moins que Neil ne souhaite éviter à tout prix à ses proches de payer des impôts sur la succession à venir, ce don est inutile. Or, rien n’est dit d’un tel calcul. On voit Neil décider de se débarrasser de ses biens sur un coup de tête. Et l’on imagine tout de même assez mal un homme capable de tout abandonner, saisi comme l’est cet homme d’une force qui le déborde, réfléchir en bon capitaliste soucieux d’optimisation fiscale.
Le don, reconnaissons-le, n’a pas grand sens, et plus probablement le personnage est-il perdu. On le serait à moins. On apprendra d’ailleurs à la fin du film que le cancer a métastasé au niveau du lobe frontal, zone du cerveau qui, comme chacun le sait, contrôle la prise de décision et les rapports sociaux. Un lobe frontal endommagé entraîne un changement de personnalité, une apathie et une réduction du langage. Rien n’empêche de voir dans l’attitude étrange de Neil et son mutisme presque total une conséquence (bête, triste et inévitable) de sa maladie.

C’est une hypothèse mais nulle preuve ne le certifie. Et surtout, on sent bien en lisant toutes ces possibles interprétations que ce n’est pas là l’essentiel. Ainsi dans Sundown les choses – explications, relations, décisions – , semblent-elles souvent un peu bancales. Peut-être du fait de la volonté du réalisateur, mais peut-être pas toujours. Et si elles s’avèrent parfois confuses, c’est parce qu’elles ne sont en réalité pas indispensables.
C’est pourquoi le film, bien que déjà très réussi, aurait gagné à taire tout à fait ce qui finalement relevait du hors champ de l’histoire – histoire qu’on peut résumer ainsi : un homme se dégage de ses obligations. Gagné à rester à l’os, nous le donner à ronger et rien de plus. Il aurait dû, je crois, renoncer à s’expliquer. On pourrait dire pour y voir clair : comme le fait Melville dans son célèbre roman, aussi simplement. En prenant le parti de se concentrer sur ce qui se joue véritablement sous nos yeux, sans doute Sundown aurait-il accru, et accru d’une manière encore plus terrible sa puissance de décomposition.

(1) Notamment, son jeu tandis qu’elle apprend l’hospitalisation puis la mort de sa mère est incroyablement juste.